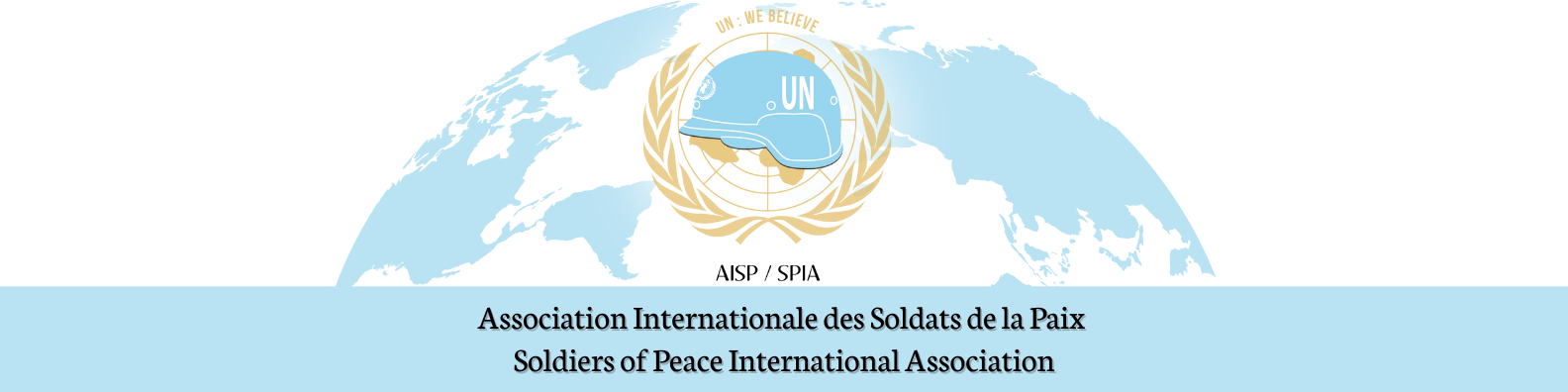Le conflit en Afghanistan est plutôt une succession de conflits et guerres civiles avec l’intervention de puissances extérieures. L’Afghanistan est un pays d’Asie centrale, sa population est inégalement répartie avec une majorité près de Kaboul et au nord du pays. Les talibans sont soutenus par le Pakistan qui voit un avenir stable pour l’Afghanistan et un allié contre l’Inde. Les attentats du 11 septembre changent la donne et l’Afghanistan s’apprête à basculer dans une nouvelle phase de la guerre. Le président des États-Unis George Bush déclare que les responsables des attentats du 11 septembre se cachent en Afghanistan sous la protection des talibans. Une opération américaine débute alors le 7 octobre 2001 et se termine le 30 août 2021. Des forces américaines et britanniques bombardent les positions talibanes et finissent par pénétrer le territoire. Avec l’aide de l’Alliance du Nord en quelques semaines, les talibans sont renversés et le reste du pays est alors aux mains de petits seigneurs de guerre, soit le nouveau gouvernement mis en place n’exerce aucune emprise sur le territoire. Les États-Unis s’empressent de mener de nombreuses opérations dans le pays, dont celle de « liberté immuable ». Le conflit en Afghanistan se situe dans une prolongation d’un conflit né à l’heure de la Guerre Froide, qui est aussi gangrené par l’intervention massive Occidentale, la corruption, et la mauvaise prise en compte des diversités ethniques et tribales. La société afghane se heurte à une instabilité constante en raison de la présence de différents acteurs sur le territoire, comme l’État Islamique, les Talibans, l’Occident et les différents clans ethniques, qui ne rassemblent pas la population afghane vers un même consensus.
Le pays est polarisé entre tous ces acteurs et peine à trouver une stabilité. L’intervention américaine exacerba d’une manière les tensions entre enjeux et acteurs locaux et participa à plonger l’Afghanistan dans une fragilité encore plus intense avec un retour des Talibans au pouvoir. Il est important de se pencher d’un point de vue sociologique sur les effets de l’intervention Américaine sur la population afghane, soit dans quelle mesure la guerre en Afghanistan 2001-2021, par le biais de l’intervention Occidentale, a-t-elle transformé la société afghane ? Les mesures prises par les Américains dans le territoire afghan ont drastiquement changé le pays sans pour autant convaincre la population afghane, favorisant l’exacerbation des tensions ethniques, le rejet de la présence occidentale et la dépendance du pays à l’intervention étrangère. Les États-Unis ont profité de ce conflit et la guerre contre la terreur pour s’implanter en Afghanistan au niveau social, politique, économique, militaire sans pour autant prendre dans sa globalité et sa complexité la population afghane, qui en paie encore aujourd’hui les conséquences. Pour mettre la focale sur la société afghane de 2001 à 2021, nous nous baserons sur des enquêtes de terrain et des analyses sociologiques. L’analyse sociologique de la société afghane de 2001 à 2021 est complexe et comporte beaucoup de paramètres qu’il est nécessaire de nuancer, tous les aspects ne pourront pas être abordés.
La société afghane se retrouve dès 2001 face à l’intervention massive occidentale dans le pays. De nombreuses enquêtes de terrain ont prouvé que cette intervention à foncièrement changé la vie et le quotidien des Afghans à tous les niveaux. Pourtant contre une politique colonialiste, les États-Unis se sont implantés dans le pays régissant une partie des règles internes. L’envoie de troupes avec le président Obama à renforcé l’envoi de nombreuses organisations sur le terrain afin de produire de l’information, de renforcer l’aide locale humanitaire. Une masse d’intervenants occidentaux arrive dans le pays. Comme le mentionne les sociologues sur le terrain dont Adam Baczko « Les enjeux sont multiples : contrats commerciaux, programmes d’aide ou de développement, réalisation d’enquêtes pour une université, production médiatique, lobbying politique ou économique, travail de renseignement ». L’afflux de personnes occidentales pour différents buts et projets est rapide vers le pays d’Asie centrale. Le paysage civil de l’Afghanistan change dès l’intervention américaine. « Les guerres civiles se traduisent généralement par la création de nouvelles institutions. L’Afghanistan ne fait pas exception : des milliers d’opérateurs, plus de 250 ONG, plus de 1500 afghanes, des OI, des entreprises, des représentations diplomatiques, des armées, des services de renseignements. Tous définissent et appliquent des politiques publiques, parfois contradictoires sur le terrain afghan. Une direction d’ensemble est cependant assurée par l’armée américaine et des bailleurs de fonds, notamment l’USAID, qui imposent quelques orientations et fixent le montant des ressources disponibles. », mentionne le chercheur et spécialiste de l’Afghanistan, Gilles Dorronsoro. Les Américains sont pourtant en décalage à tous les niveaux avec la population afghane. La population reste encore pauvre, peu moderne et la géographie, la culture, les traditions, les grilles de lecture du politique et du religieux semblent à des années lumières des États-Unis et leur vision du monde.
De plus les américains placent leur aide et leur influence vers une forme d’instrumentalisation de « la plus petite puissance », on parle du global au local. L’OTAN se révèle aussi être une machine au service des USA et les puissances occidentales alliés dont la France et le Royaume Unis, dominées par les USA. L’intervention américaine plonge le pays dans une économie de guerre, la société change et le corps civil se met au service des États-Unis, le congrès a affecté plus de 132 milliards de dollars d’aide à l’Afghanistan entre 2002 et 2018, dont 63% pour la sécurité, 28 % pour le développement et le reste pour des opérations civiles et humanitaires. Dans l’objectif commun d’obtenir plus de financement, la contre-insurrection a favorisé une mobilisation des programmes civils au service d’objectifs militaires. « Les opérateurs civils sont les exécutants des demandes du secteur sécuritaire dans des domaines aussi variés que le BTP, le développement agricole et les études d’opinion », explique Dorronsoro. La période de domination occidentale en Afghanistan marque aussi une forme de ségrégation entre afghans et occidentaux. Les locaux se retrouvent défavorisés face aux occidentaux et n’ont pas les mêmes avantages sociaux. Dans certains cas, il est nécessaire de nuancer ces faits, mais on assiste également à un rejet de la culture et des traditions locales par les occidentaux. « Les toilettes réservés aux Occidentaux sur la base américaine de Bagram ou l’interdiction des vêtements afghans à la cantine de celle de Kandahar, sont des indices de cette mise à distance », mentionne Joe Friesen ou encore comme l’explique Luke Mogelson, correspondant de guerre américain : « De même, les hôpitaux militaires occidentaux, bien que sous-utilisés en dehors de courtes périodes, sont généralement fermés à la population locale, alors que le déficit en équipement de santé est criant. » Les enquêtes de terrains témoignent de cette mise à distance de l’afghan face à l’occidental, qui permet alors de favoriser un sentiment de rejet de l’Occident en Afghanistan.
Les 10 000 étrangers présents en Afghanistan durant la période d’intervention américaine, évoluent dans une bulle avec des conditions de vie et des habitudes quotidiennes qui contrastent brutalement avec celles du pays. Ici Dorronsoro nous exposent encore certains détails qui témoignent du changement de vie des afghans, qui doivent maintenant composer avec les occidentaux, « D’un point de vue moins anecdotique qu’il n’y paraît, la capitale a vu apparaître des lieux de sociabilité interdits à la population locale. La vente d’alcool, illégale mais tolérée en Afghanistan, permet de refuser l’entrée d’un lieu aux nationaux. Le bar L’Atmosphère, excluant ainsi les Afghans, ce qui garantissait l’entre-soi des étrangers. Un deuxième exemple, qui a plus de poids dans la vie quotidienne, est l’établissement de zones à accès restreint qui isolent les ambassades occidentales à Kaboul sur le modèle de la Green Zone de Bagdad et aggravent considérablement les embouteillages dans le centre-ville. » La dépendance financière de l’Afghanistan auprès de l’étranger est telle, qu’elle empêche toute forme d’autonomie à l’Afghanistan. En 2009, les États-Unis ont dépensé l’équivalent du PIB afghan soit, 14 milliards de dollars uniquement pour des questions de nécessité à leur présence sur le terrain. L’intervention américaine a offert un soutien militaire et financier, court-circuitant l’État et consolidant l’autonomie des gouverneurs provinciaux et chefs de milices. Toutefois les États-Unis ont d’une manière légitimer les programmes locaux, instaurant dès 2001 des programmes qui leur sont propres sur le terrain. De cette manière la société afghane s’est vue rencontrée une réelle crise du marché de l’emploi, faussée avec l’arrivée des USA, endossant de biens meilleurs postes et salaires que les locaux. C’est un autre aspect qui permet de comprendre le sentiment anti-occidental de la population, et l’envie d’aller trouver mieux chez d’autres acteurs.
L’implantation trop brutale des forces occidentales dans le pays, a participé à cristalliser la violence, exacerbant le conflit ethniques et idéologiques entre les différents acteurs. La population ne semble pas se rassembler autour d’un consensus et montre un sentiment de déception face à l’intervention occidentale. Le politologue Christoph Zürcher réalise une étude sur les programmes d’aide afin de promouvoir la désescalade de la violence et leur échec. « Sur les dix-neuf études, une seule a été entreprise par un acteur du développement, alors que quatre ont été financées par les militaires, soulignant à nouveau la sécurisation de l’aide. Deuxièmement, l’étude montre que la preuve que l’aide atténue la violence dans les zones de conflit n’est pas très forte. Dans l’ensemble, l’aide dans les zones de conflit a plus de chances d’exacerber la violence que de l’atténuer. Cela vaut notamment pour l’aide “en première ligne” qui est investie dans des régions hautement sécurisées, avec une forte présence des forces anti-gouvernementales. Plus préoccupant encore, l’aide humanitaire est invariablement associée à plus – et non moins – de violence. En outre, l’aide fournie par l’armée et les projets de développement communautaires mis en œuvre dans des régions instables atténuent rarement la violence ».
De plus, on remarque également que l’Afghanistan ne devient plus aussi hermétique au niveau de sa politique interne. La présence occidentale pénètre la sphère politique au niveau du ministère de l’intérieur. Ce dernier comptait 282 conseillers étrangers, dont 120 sous contractants, soit une masse salariale de 36 millions de dollars, son département de logistique avait une majorité d’internationaux, soit 45 pour 14 locaux. L’omniprésence de consultants favorise une sorte de turnover chez les cadres et empêche le développement et la qualification interne ainsi que la création d’un sentiment d’unité. En imposant la présence de consultants internationaux avec la coordination d’acteurs privés, l’État Afghan perd sa capacité à se poser en représentant du bien commun et œuvrer pour une politique plus sociale et promouvoir l’intérêt général de la population. Les États-Unis créent ANCOP en Afghanistan, soit une police locale formée par leurs soins, toutefois cette dernière est créée trop tardivement pour être efficace et se heurte à des problématiques endémiques, comme la corruption. Dorronsoro l’explique dans son travail de recherche ; Le gouvernement transnational de l’Afghanistan, « Alors que l’armée reste protégée dans ses bases, la police et les milices subissent la majorité des attaques et cette pression croissante aboutit dans certains endroits à des accords locaux avec les Talibans, entraînant graduellement une dissolution du dispositif de sécurité dans les districts périphériques. ». Ce qui prouve bien que les Américains n’ont pas su prendre en compte tous les paramètres qui forment les règles, coutumes et habitudes afghanes. « En lieu et place d’une mobilisation politique, on assiste à l’émergence d’une « société civile » produite par les financements internationaux ».
Même si l’intervention occidentale en Afghanistan n’a pas été qu’un échec cuisant pour la population locale, il est clair qu’elle a autant participé à creuser les tensions, parfois de manière inconsciente. En 2010 l’aide international pour l’Afghanistan se lève à 16 milliards $, ce qui a considérablement boosté à l’économie afghane, qui s’est dotée de technologie, téléphone, ordinateur, parc automobile. Cette somme n’aurait jamais été induite sans la présence étrangère sur le terrain, mais d’un autre côté la modernisation technologique sert aussi à des acteurs comme l’État Islamique ou les Talibans. Les mesures libérales imposées par l’international se sont heurtées à une forte résistance, malgré la création de la FIAS. En effet, le nouveau régime instauré en 2002, après la chute du régime Taliban, n’a fait que reconduire l’opposition qui existait entre celle-ci et les Talibans, mettant au jour, comme le mentionne Dorronsoro, une sorte de « malentendu entre la légitimation de l’invasion par la défense des droits humains et la position des acteurs afghans, pour qui la charia fait consensus et dont le rejet des Talibans portait sur d’autres enjeux. »
L’anthropologue Richard Tapper reconnaît que les occidentaux ont joué un rôle très important dans la redéfinition des identités et la construction d’une nouvelle constitution, qui inclut l’usage du droit chiite. De plus, dix sièges au Parlement sont réservés à des occidentaux. Ce qui marque encore une fois l’intervention et la présence occidentale dans les affaires internes de l’Afghanistan. Les Américains composent un nouveau système interne en Afghanistan selon leurs règles. L’Afghanistan d’aujourd’hui est avant tout le produit d’interventions extérieures et d’ingérences. Après 2001, avec l’intervention américaine, l’Afghanistan devient totalement dépendant des soutiens extérieurs. L’Afghanistan à toujours composé avec des soutiens financiers, militaires et sécuritaires extérieurs, mais sa position reste en réalité la même. Le pays reste dépendant des puissances régionales et internationales pour sa survie. L’Afghanistan est alors incapable de se relever seul. Les faiblesses du pays sont alors instrumentalisées au profit des occidentaux. Déjà avec le règne d’Abdul Rahman Khan, le pays était marqué par des tensions ethniques avec des répressions sur les Pachtounes, et le déplacement des Hazaras au nord, qui se sont alors appropriés de force des terres autochtones. Ce qui prouve alors qu’avant toute intervention étrangère le pays était déjà enclin aux conflits ethniques. Les événements du 11 septembre changent complètement la focale de la diplomatie américaine et sont le déclenchement de l’intervention américaine en Afghanistan. Les États-Unis sont traumatisés par le 11 septembre et œuvre en Afghanistan dans la dynamique de « la guerre contre la terreur ». Les États-Unis se sont alors servis des faiblesses du pays pour exercer leur domination en interne, en se présentant comme un pays non colonialiste mais en réalité exerçant des processus comme l’arbitrage international privé, des enclaves territoriales humanitaires, militaires et écologiques, ce qui oriente alors considérablement les politiques publiques du pays. La sociologue Anne Marijnen met en lumière l’aspect « transnational » du gouvernement afghan, un reflet de la société afghane après 2001.« En Afghanistan, le gouvernement transnational a généralisé et radicalisé ces processus en multipliant les régimes juridiques d’exception et en plaçant les opérateurs internationaux en position dominante dans tous les secteurs. Mais si le néolibéralisme contemporain, par son tournant anti-redistributif et sécuritaire, installe un état de guerre sociale dans les pays occidentaux, les mêmes dispositifs dans d’autres contextes créent les conditions propices à la guerre civile. D’une part, la multiplication des intermédiaires et des sous-traitants dans la conduite des politiques publiques produit un contournement général des institutions étatiques ; la sous-administration de l’Afghanistan vide l’État de ses compétences et accélère sa délégitimation. D’autre part, la présence d’opérateurs étrangers ne se traduit pas par une plus grande efficacité dans la réalisation des politiques publiques, car la rationalisation sectorielle, quand elle n’est pas coordonnée, produit du chaos ou de l’instabilité. » La conduite du gouvernement afghan entre 2001 et 2021, dépasse le cadre national et concerne l’intervention et l’influence de plusieurs autres nations, ce qui traduit d’une manière une incohérence de l’interprétation de la société afghane depuis la guerre, des changements inadaptés et la croissance des conflits à tous niveaux dans le pays.
La présence occidentale en Afghanistan a eu un effet ambivalent sur la société locale. En effet la situation s’est dégradée en Afghanistan, ce qui a aussi permis aux Talibans de revenir au pouvoir. La dégradation des problématiques internes vient aussi d’une mauvaise prise en compte de la complexité de la société afghane dans sa globalité par les occidentaux. La quasi-totalité est musulmane avec 20% de sunnites et 80% de chiites. C’est également un pays multiethnique, l’ethnie la plus représentée est celle des Pachtounes, mais on retrouve aussi les Hazaras, les Tadjiks, les Aimaks, les Pamiris, les Turkmènes et les Ouzbeks. Les conflits ethniques étaient déjà présents, mais l’intervention américaine a aussi participé à creuser ces tensions. En effet la guerre en Afghanistan prend racine dans plusieurs paramètres mais détient aussi un arrière-fond causé par des conflits ethniques internes qui datent de bien avant l’intervention américaine. Les membres de l’armée afghane viennent de régions et de tribus différentes, ce qui participe à animer les conflits interethniques et aussi la pénétration de membres des Talibans au sein de l’armée. Le caractère tribal en Afghanistan est un aspect étranger pour les occidentaux.
Dorronsoro évoque le cas du gouverneur de la province de Paktiya qui peine à collaborer avec les chefs de tribus locales car il vient d’une autre tribu. L’auteur explique que la société afghane se constitue de petits groupes locaux avant tout
« – peut-être même la plupart – prêtent d’abord allégeance aux leaders locaux, aux groupes ethniques et aux tribus », les États-Unis doivent seulement chercher à assurer « les conditions minimales pour une civilisation médiévale ». En conséquence, « la majorité de l’aide occidentale ne devrait pas passer par le gouvernement afghan – même en supposant que la manifestation d’un gouvernement national représentatif puisse se maintenir – mais aller directement aux régions afghanes ». Les États-Unis auraient dû privilégier le local et prendre la population dans sa globalité avec ses spécificités locales et tribales mais cela reste compliqué d’aligner les États-Unis avec une conception de la société très éloignée de la leur, qui se trouve entre chefs locaux, gouvernement central, tribus ethniques et groupes armés armés. De plus, la population afghane subit de nombreuses mutations, d’autant plus avec la guerre, 76% des Afghans ont été forcés de quitter leur domicile à un moment de la guerre, 42% sont partis en exil et 41% ont été déplacés. L’anthropologue Alessandro Monsutti explique dans son ouvrage Guerre et migrations : réseaux sociaux et stratégies économiques des Hazaras d’Afghanistan que le nombre de déplacés internes (IDP) serait de plus de 1,8 million depuis 2004, dont près de 500 000 pour la seule année 2017, 1,8 million d’Afghans sont revenus du Pakistan depuis 2001. Les Afghans ont une expérience de la migration, des différences culturelles, linguistiques et des réseaux à longue distance bien supérieure à celle des Occidentaux. C’est avec toute cette complexité que le rôle de fixer devient essentiel afin d’appréhender et mieux comprendre la société afghane pour des occidentaux. Dans des pays instables, les fixer deviennent un élément essentiel pour l’intervention étrangère, et forment ce lien entre l’intervention et la société locale.
Analyse du documentaire “ Fixer “, réalisé par Charles Villa et Nils Montel pour le média BRUT en 2022 :
Hussain est un afghan de 35 ans, il est journaliste et fixeur, ainsi il a collaboré avec des médias internationaux tels que CNN, Al Jazeera et Brut depuis 2019. Son rôle essentiel consistait à faciliter l’accès des journalistes étrangers aux zones sensibles, en assurant leur sécurité et en leur fournissant des informations locales cruciales.
Hussain, comme beaucoup d’afghan a déjà avant la guerre de 2001-2021 une expérience de la guerre et de la violence dans le pays. Cette expérience de la guerre, il la mentionne à plusieurs reprises. Le fait de connaître ce genre de situation montre que la population afghane vit depuis trop longtemps dans la violence. Hussain explique qu’en tant que journaliste sa vie été toujours en danger sous le régime Taliban. Les occidentaux ont d’une manière permit de rendre plus de liberté à la population et à certains groupes pris pour cible par le gouvernement taliban. Cette vidéo appuie notre analyse sur les changements de la société afghane suite à l’intervention occidentale. Les fixeurs prennent une place très particulière dans un conflit, ici à la fois perçu comme un danger ou opportunité suivant les camps. Dans un contexte de guerre comme en Afghanistan, le fixeur devient fixer par volonté militante, par la force, ou pour l’aspect financier, toutefois il reste une cible et prend de grands risques à collaborer avec les occidentaux. Le fixeur reste une clef essentielle, il est le lien avec le local et une couverture pour l’étranger dans un contexte de guerre. Pourtant, fournissant une aide considérable à la coalition, le fixeur est perçu comme un traître à la nation. Le rôle du Fixer est de collaborer avec l’intervention étrangère sous contrat, toutefois les contrats ne sont pas toujours respectés. Les fixeurs exercent aussi cette activité pour faciliter leur exfiltration du pays, mais comme on le voit avec Hussain, l’exfiltration n’est pas aussi simple et les fixer sont souvent utilisés et laissés sur place lors du retrait étranger.
Hussain met en image la violence et la volonté de la population de partir de Kaboul mais aussi la crise dans laquelle se trouve le pays dès le retrait Occidental. Dans ces images, Hussain a l’espoir de repartir avec les forces spéciales françaises. Les fixeurs sont une partie de la population instrumentalisée dans les conflits afin de produire de l’information mais ils restent livrés à eux-mêmes par la suite. Même si Hussain et sa famille finiront par regagner la France et obtiendront le statut de réfugiés politiques, la plupart des fixeurs ne l’obtiennent pas et restent sur place, contraints de se cacher ou de faire face à des formes sanctions pour leurs activités. Le fixeur et sa position délicate est aussi une conséquence de l’intervention occidentale en Afghanistan. Pourtant suivant les cas, ces activités peuvent faciliter le départ pour se réfugier vers des pays plus stables. Le travail de fixer est un travail informel et résulte de l’implantation occidentale dans le pays.
L’ingérence américaine participe d’une manière à transformer certaines tribus en instrument d’État. Les États-Unis procèdent dans une dynamique qui leur est propre, vis-à-vis de leur propre histoire civilisationnelle et de leur diplomatie des années 2000. Négocier, même localement avec l’insurrection est rejeté par les militaires américains, les Talibans ne se sont en effet pas considérés comme des interlocuteurs acceptables. Comme le mentionne Hervé Ghesquière dans 547 jours, les Talibans se présentent non pas comme des rebelles mais comme des résistants, l’ingérence américaine a aussi permis aux Talibans d’accroître leur mouvement, rassemblant des combattants sous l’étendard du rejet occidental et sous une lassitude générale face au gouvernement en place durant la guerre, ce qui explique aujourd’hui le retour des Talibans au pouvoir depuis 2021. En conséquence, les Talibans ont joué un jeu ambigu durant la guerre, mobilisant dans certains endroits les Pachtounes autour d’une thématique implicitement ethnique (province de Badghis par exemple), mais s’ouvrant en même temps aux autres groupes. Les Talibans ont donc élargi leur recrutement d’un point de vue stratégique et Trans ethnique. Le groupe Taliban et son influence dans le pays entraînent des évolutions sociologiques. Les Talibans, fervents défenseurs de la culture patriarcale, sont des produits des madrassas. Comme l’explique Olivier Roy, beaucoup d’entre eux se rapprochent d’une sorte de culture « incel » américaine, doublée d’une sorte de frustration sexuelle et d’une absence de sociabilité. D’un point de vie sociologique cet aspect-là peut aussi permettre d’accroître les peurs et craintes des Talibans sur ce que représentent les femmes et les occidentaux.
Dorronsoro explique aussi que l’intervention américaine s’est aussi réalisée dans la violence pour la population, ce qui oriente alors la population à opter pour le rejet de la présence occidentale. La population subit le traumatisme de cette présence. Dans un entretien avec un local en 2011, « À Ghaziabad, avant 2006, les soldats américains courent en short, sur la route, torse nu. […] Les fouilles des maisons la nuit ont mené à la violence. Beaucoup étaient choqués, les soldats américains faisaient des signes aux femmes, ils entraient parfois dans les maisons sans l’ANA, faisant exploser la porte sans même avoir essayé de frapper ». Le sociologue ajoute « du fait de cette distance entretenue, les forces occidentales ont souvent ignoré les codes culturels de la société afghane. Comme l’explique un interlocuteur dans la Kunar, les conditions d’intervention, en particulier durant les premières années, sont menées dans un mépris total des sensibilités locales ».
Le 23 février 2013, dans la province de Wardak en Afghanistan des villageois ont manifesté contre la présence des forces spéciales américaines, qu’ils accusent d’avoir pratiqué des tortures. Cette manifestation démontre une opposition ferme à la présence occidental et conforte l’idée qu’un traumatisme persiste au sein de la population. Ici, des Afghans manifestent avec les photos des victimes. Les Américains pénètrent la société afghane selon leurs règles et se heurtent à un mécontentement d’une partie de la population. Cette situation peut en effet provoquer un sentiment de lassitude de la population et pousser certains à chercher un peu plus d’espoir vers d’autres acteurs comme l’État Islamique ou les Talibans. Cette photo atteste également d’une certaine liberté d’expression en 2013. Les États-Unis, fervents défenseurs du respect des Droits de l’Homme, violent ici un autre droit fondamental. Toutefois ces manifestations restent tolérées durant la période sous influence occidentale, mais avec le retour des Talibans les formes de manifestations sont dispersées et punies depuis 2021. Pourtant de plus en plus de femmes afghanes militent pour leurs droits, mais font face à des répressions de plus en plus violentes avec le retour des Talibans. De plus, il est aussi possible que ces formes de manifestations en 2013 formaient une sorte d’avantage pour le groupe Taliban dans sa quête du retour au pouvoir. Le cadrage social ici, traduit alors le rejet de la présence américaine dans le pays, et le fait que les Américains n’ont pas su appréhender le pays dans la dynamique de l’aider et de le stabiliser à tous niveaux, social, économique, politique, tribal, sécuritaire.
En mars 2005, le Pentagone étend sa mission en Afghanistan pour y inclure la lutte contre la drogue, ce qui a pour seul effet d’ajouter un niveau d’incohérence supplémentaire. La culture du pavot représentait 35% du PIB du pays, soit l’Afghanistan était le premier exportateur d’opium mondial. La lutte contre cette production a plongé le pays dans une crise et force les cultivateurs à s’orienter vers d’autres cultures moins lucratives et augmente aussi le taux de chômage et de migration. Le retrait des occidentaux plonge aussi la société afghane dans une situation chaotique, livrée à elle-même avec les mêmes problématiques endémiques et l’accroissement de tensions suite à l’intervention américaine. De nombreux bâtiments, écoles, routes, cliniques, construits par les Américains restent inachevés, car la bulle immobilière restait alimentée par les Américains jusqu’en 2021. Le retrait laisse le pays dans l’instabilité et une pauvreté grandissante sans aucune possible autonomie.
« Les réunions du National Security Council révèlent en effet un consensus sur un retrait rapide des forces américaines et un profond désintérêt pour la dynamique politique interne en Afghanistan » explique Douglas Feith. Les Américains ont présenté leur intervention en Afghanistan comme allant à l’opposé de l’archétype de la guerre du Vietnam, une guerre coloniale et de domination pourtant, leur intervention en Afghanistan propose des dynamiques similaires. Doronsorro et Baczko expliquent que cette guerre en Afghanistan est d’une complexité sans précédent. Pourtant ce conflit évolue et prend un caractère contemporain. On assiste à une nouvelle forme de guerre au XXIème siècle, pourtant les racines du conflit restent les mêmes qu’au XXème siècle. Dans leur œuvre Pour une approche sociologique des guerres civiles, Baczko et Dorronsoro confirment l’idée qu’il y ait une production internationale de la guerre civile, ces dernières seraient alors des phénomènes transnationaux et des nouveaux acteurs non militaires y interviendraient aussi, soit des ONG, OI. Les réfugiés sont les produits universels de ces nouvelles formes de guerres et les mouvements armés disposent d’un territoire de refuge dans un pays voisin. De plus, les enjeux qui orientent les protagonistes de ces luttes sont largement contraints par le système international. Les nouvelles formes de guerres contemporaines, comme on le voit avec le cas de l’Afghanistan 2001-2021, créent de nouveaux enjeux de domination, de contrôle ou d’influence par le biais de l’ingérence étrangère, cachée sous un fond d’enjeux régionaux sécuritaires et globaux. Les nouvelles formes de guerres sont locales et deviennent des enjeux à dimensions internationales, la guerre contemporaine détient un nouveau cadrage. La guerre en Afghanistan de 2001-2021 a entraîné des conséquences majeures sur la société afghane, la mauvaise prise en compte du pays et de sa population n’a fait que déstabiliser le pays et alimenter les tensions, qui mènent aujourd’hui à voir l’Afghanistan comme un pays accidenté entre l’Iran et le Pakistan, régit par le règne des Talibans et enclavé dans une région complexe, enclin aux rivalités et à l’instabilité sociale.
Laurie FABRE
Bibliographie
Ouvrages :
- CENTLIVRES, Pierre. State, National Awareness and Levels of Identity in Afghanistan from Monarchy to Islamic State. Central Asian Survey, 2000.
- CHARBONNEAU, B., DEBOS, M. « De la ‘guerre contre le terrorisme’ aux guerres sans fins : la co-production de la violence en Afghanistan, au Mali et au Tchad ». Cultures et Conflits, n°123-124, 2021.
- DORRONSORO, Gilles. Le gouvernement transnational de l’Afghanistan. Une si prévisible défaite. Paris : Éditions Karthala, 2021.
- MICHAILOF, Serge. « L’échec du Nation Building ». Afghanistan : autopsie d’un désastre, 2011-2021. Paris : Gallimard, 2022.
- MOGELSON, Luke. Ces morts heureux et héroïques. Paris : Gallmeister, 2008.
- MONSUTTI, Alessandro. « L’Afghanistan : d’une guerre à l’autre, évolutions internes et dynamiques régionales ». Cahier d’étude sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, Paris, 1995.
- ROY, Olivier. Nations sans nationalisme. Paris : Presses Universitaires de France, 1998.
- ROY, Olivier. Ethnies et appartenance politiques en Afghanistan : le fait ethnique en Iran et Afghanistan. Paris, 1988.
- GHESQUIERE, Hervé. 547 jours. Paris : Albin Michel, 2012.
- Articles :
- BACZKO, Adam, DORRONSORO, Gilles. « Pour une approche sociologique des guerres civiles ». Revue Française de Science Politique, vol. 67, n°2, 2017, p. 309-327.
- BACZKO, Adam. « Les revers de l’Armée américaine dans la guerre d’Afghanistan : le cas de la Kunar ». Politique américaine, Paris, 2012.
- BARFIELD, Thomas. Afghanistan : A Cultural and Political History. Princeton : Princeton University Press, 2010.
- DESSART, Laurent. La civilisation des Pachtounes d’Afghanistan et du Pakistan. Paris : L’Harmattan, 2022.
- « De la stabilité de l’Etat en Afghanistan ». Annales, Histoire, Sciences sociales, 59, Paris, 2004.
- DORRONSORO, Gilles, HEARLING, Peter. « La guerre américaine en Irak et en Afghanistan : entre vision messianique et ajustement tactique ». Politique étrangère, 70, Paris, 2005.
- MALEJACQ, R., OLSSIN, C. « Reculer pour mieux sauter ? Délégation et monopolisation de la violence en Afghanistan ». Revue canadienne de science politique, juin 2021.
- ROY, Olivier. « Y’a-t-il un avenir en Afghanistan ? » Esprit, n°478, Paris, 2021.
- SHARAN, Timor, BOSE, Srinjoy. « Political networks and the 2014 Afghan presidential election: power restructuring, ethnicity and state stability ». Conflict, Security & Development, 2016.
- WASINKI, Christophe. « Reconnaître l’absence et dire les responsabilités : le cas des civils tués par les forces armées américaines en Afghanistan et en Irak ». Cultures & Conflits, n°87, Paris, 2012.
- ZURCHER, Christoph. The Post-Soviet Wars: Rebellion, Ethnic Conflict and Nationhood in the Caucasus. New York : New York Press, 2007