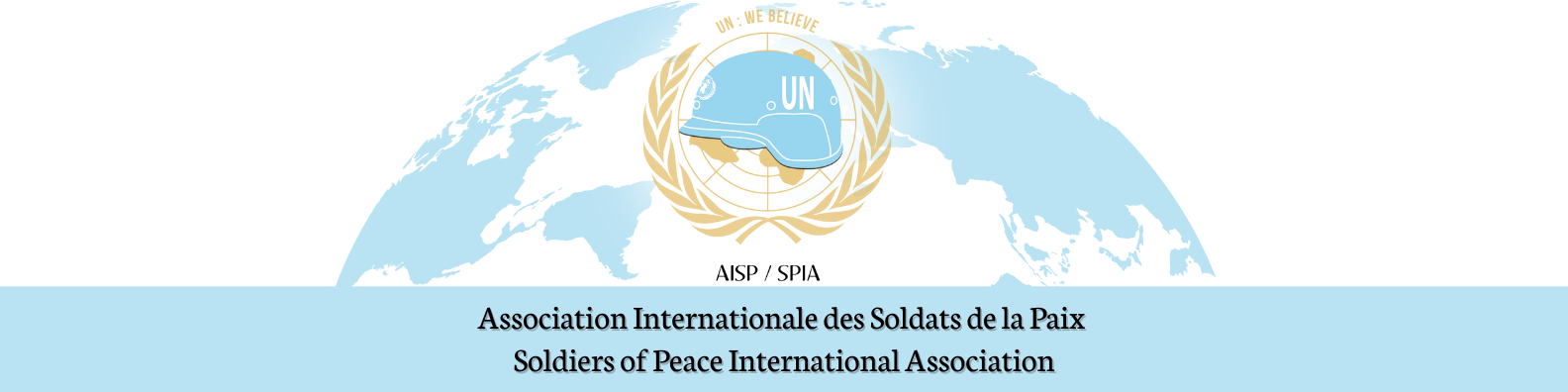La résolution 1325 a été adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies le 31 Octobre 2000 dans sa 4231ème séance. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies adoptait la résolution à l’unanimité, affirmant pour la première fois le rôle central des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, les négociations de paix, la consolidation de la paix, les opérations humanitaires et la reconstruction post-conflit. Ce texte fondateur a constitué un tournant historique : il ne s’agissait plus seulement de protéger les femmes des violences en temps de guerre, mais de les reconnaître comme actrices à part entière de la paix et de la sécurité internationales.
Vingt-cinq ans plus tard, les ambitions affichées par la communauté internationale se heurtent à des réalités plus nuancées. Si l’architecture normative s’est largement étoffée, les chiffres sont sans appel : la participation des femmes aux négociations de paix demeure inférieure à 10 %, un taux qui n’a quasiment pas évolué depuis une décennie1. Dans le même temps, les femmes continuent de subir de plein fouet les effets des conflits, qu’il s’agisse de violences sexuelles, de déplacements forcés ou d’atteintes à leurs droits fondamentaux2.
Cette stagnation dans les faits contraste vivement avec l’abondance des engagements formels. Depuis 2000, le Conseil de sécurité a adopté une série de résolutions complémentaires – notamment les résolutions 18203(2008) sur les violences sexuelles, 18894 (2009) sur la participation post-conflit, ou encore 24675(2019) réaffirmant la lutte contre l’impunité – qui ont contribué à ériger un véritable agenda « Femmes, paix et sécurité » (WPS6). La résolution 2467 par exemple reconnaît pour la première fois que « les normes et pratiques sociales préjudiciables, les inégalités structurelles, et vues discriminatoires sur les femmes ou les rôles des hommes et des femmes dans la société » exacerbent les violences sexuelles ou fondées sur le genre en période de conflit ou d’après-conflit.
De nombreux États ont également élaboré des Plans d’action nationaux, censés décliner les principes de la résolution 1325 en politiques publiques concrètes. En parallèle, la société civile, et en particulier les réseaux transnationaux, n’a cessé de jouer un rôle moteur pour faire vivre cet agenda, souvent en l’absence de volonté politique claire au niveau étatique.
Pourtant, ces avancées normatives peinent à se traduire par des effets structurants sur le terrain. Comme l’indique le Conseil de sécurité dans son communiqué de 20247, la présence symbolique des femmes dans les processus de négociations de paix est souvent instrumentalisée pour répondre à des exigences de conformité, sans que leur voix ne soit réellement entendue ou prise en compte dans les décisions stratégiques. Cette forme de « participation de façade » souligne l’écart persistant entre l’égalité formelle et l’égalité réelle.
Par ailleurs, les femmes demeurent les premières victimes des déséquilibres systémiques engendrés par les conflits armés. Le communiqué souligne une augmentation alarmante des violences sexuelles en contexte de guerre (+50 % en 20238), ainsi qu’un doublement du nombre de femmes tuées dans les zones de conflit. Ces chiffres rappellent que, malgré l’existence de cadres juridiques internationaux de protection, les violations restent massives et rarement sanctionnées. Les infrastructures de santé étant fréquemment détruites, les femmes sont également plus exposées à la mortalité maternelle, aux infections, et à l’effondrement des services sociaux de base. En somme, les conflits n’affectent pas les femmes de manière « égale » : ils exacerbent des vulnérabilités préexistantes, dans un contexte global de discrimination systémique encore largement impensée dans les politiques de sécurité.
Ainsi, le contraste entre l’abondance des instruments normatifs et la faiblesse de leur mise en œuvre constitue l’un des principaux écueils de la résolution 1325. Cette dissonance invite à un examen critique, non pas de son bien-fondé, mais de sa traduction concrète. Elle pose également la question de la sincérité politique des États et des institutions internationales dans la promotion de la paix inclusive. Nous analyserons tout d’abord les apports juridiques et politiques de la résolution et de l’agenda « Femmes, paix et sécurité » (I), avant d’évaluer la portée réelle de leur mise en œuvre un quart de siècle plus tard (II).
2
I/ Une résolution fondatrice pour une approche genrée de la paix et de la sécurité
Adoptée dans un contexte post-génocidaire et post-conflit marqué par les violences de masse au Rwanda et en ex-Yougoslavie, la résolution 1325 représente un tournant historique dans la manière dont le droit international envisage les liens entre genre, guerre et sécurité. Pour la première fois, le Conseil de sécurité reconnaît officiellement que la participation active des femmes à tous les niveaux des processus de paix et de reconstruction est essentielle à la stabilité des sociétés. Ce texte a également contribué à transformer les représentations classiques de la sécurité, longtemps centrées sur les États et l’usage de la force, vers une vision plus inclusive, attentive aux vulnérabilités sociales et aux dynamiques locales.
La première partie (A) reviendra sur la genèse et la portée globale de cette résolution. Elle montrera comment la reconnaissance formelle du rôle des femmes dans la paix et la sécurité a progressivement structuré un nouvel agenda international, encore aujourd’hui inachevé.
Cependant, si l’architecture normative issue de la résolution 1325 a favorisé une meilleure visibilité des femmes dans les discours et politiques de sécurité, ses effets restent inégalement répartis selon les contextes, les régions et les profils des femmes concernées. La seconde partie (B) propose d’interroger les effets globaux de la résolution à l’aune des dynamiques intersectionnelles : car toutes les femmes ne vivent pas la guerre, ni la paix, de la même manière.
A. Un cadre normatif international renforcé
L’adoption de la Résolution 1325 en 2000 par le Conseil de sécurité des Nations Unies marque une avancée majeure en liant, pour la première fois, l’égalité de genre à la paix et à la sécurité internationales. Elle reconnaît la nécessité d’inclure les femmes dans tous les aspects des processus de paix, à la fois comme victimes spécifiques des conflits et comme actrices de leur résolution. Dans les années suivantes, un ensemble de résolutions complémentaires a étoffé ce cadre, formant l’agenda « Femmes, paix et sécurité » (WPS). Ces textes, bien que non juridiquement contraignants, ont une portée normative importante et ont été traduits localement par des Plans d’action nationaux, aujourd’hui adoptés dans plus de 100 pays. Cette dynamique a permis une institutionnalisation progressive de la perspective de genre dans les politiques de sécurité, aussi bien à l’échelle nationale que régionale.
Enfin, des mécanismes de suivi ont été progressivement instaurés afin de traduire les principes du WPS agenda en obligations mesurables et en outils d’évaluation. Dès 2010, à la demande du Conseil de sécurité, un ensemble de 26 indicateurs mondiaux a été proposé par le Secrétaire général dans le rapport S/2010/498, couvrant les quatre piliers de l’agenda : Participation, protection, prévention, et secours/reconstruction. Ces indicateurs incluent par exemple le nombre de femmes médiatrices dans les processus de paix, la proportion de personnel féminin dans les opérations de maintien de la paix, ou encore le nombre de lois nationales visant à sanctionner les violences sexuelles liées aux conflits.
Ces données sont intégrées dans le rapport annuel du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité, qui fait état, chaque année, des progrès réalisés, des lacunes persistantes, et des recommandations à l’attention des États membres et des agences onusiennes. Ce rapport constitue aujourd’hui une source centrale de redevabilité, car il permet de suivre, de manière comparative, les politiques mises en place par les États, ainsi que l’évolution des pratiques institutionnelles.
Parallèlement, des outils ont été développés par ONU Femmes pour accompagner les États dans la mise en œuvre de leurs Plans d’action nationaux, notamment à travers des cadres de suivi participatif, des formations, et des évaluations indépendantes. Des plateformes comme le WPS National Action Plan Database, mise en ligne par l’Institut de recherches internationales de Georgetown, permettent également de comparer la portée, les budgets et les priorités des plans d’actions nationaux dans différents pays.
Cependant, ces outils restent largement dépendants de la volonté politique des États à produire et partager des données fiables. De nombreux rapports nationaux demeurent incomplets, auto-déclaratifs, voire absents. En outre, le manque de financement alloué au suivi-évaluation, conjugué à l’absence de mécanismes contraignants, limite considérablement l’effet incitatif de ces dispositifs. Le rapport de 2024 souligne une nouvelle fois que moins de 1 % des financements consacrés à la paix et à la sécurité est orienté vers des initiatives intégrant une perspective de genre9.
C’est précisément cette tension entre intentions affichées et résultats concrets que nous interrogerons dans la section suivante, en mobilisant une lecture intersectionnelle des effets globaux de la Résolution 1325.
B. Des effets globaux
L’impact de la résolution 1325 ne peut être appréhendé de manière uniforme. Bien que le texte énonce des principes universels, les conditions de mise en œuvre et les effets concrets varient considérablement selon les contextes culturels, politiques, économiques et géographiques. C’est là qu’intervient l’approche intersectionnelle, développée initialement par Kimberlé Crenshaw10 dans le champ du droit, qui permet de mieux comprendre la manière dont différentes oppressions (genre, race, classe, orientation sexuelle, statut migratoire, etc.) s’entrelacent et produisent des vulnérabilités différenciées.
Dans le cadre des conflits armés, certaines femmes se trouvent à l’intersection de plusieurs formes de marginalisation : les femmes réfugiées, déplacées internes, autochtones, issues de minorités ethniques ou vivant avec un handicap subissent des violences spécifiques, souvent invisibilisées dans les politiques publiques. Or, la Résolution 1325, dans sa rédaction initiale, tend à présenter « les femmes » comme un bloc homogène, sans prendre en compte ces différenciations fondamentales. Ce biais a parfois conduit à des politiques de paix genrées mais non inclusives, renforçant la visibilité de certaines catégories de femmes (souvent éduquées, urbaines, proches des élites politiques ou des ONG internationales), au détriment des autres.
Après la guerre civile libérienne (1989–2003), le Liberia a été présenté comme un modèle de mise en œuvre de la Résolution 1325, notamment avec l’élection d’Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue par le suffrage universel à la tête d’un État africain, et la forte mobilisation du mouvement Women of Liberia Mass Action for Peace11. Toutefois, comme l’a montré la chercheuse Funmi Olonisakin12, les initiatives de paix post-conflit ont largement mobilisé des femmes éduquées, anglophones et proches des milieux urbains et diplomatiques, laissant de côté les femmes rurales, analphabètes ou isolées géographiquement, qui avaient pourtant subi les pires violences pendant le conflit.
Durant les négociations entre le gouvernement colombien et les FARC (2012–2016), la « Sous-commission de genre13 » a été une innovation saluée. Pourtant, les représentants des femmes dans cette sous-commission étaient principalement issues de la classe moyenne, blanches ou métissées, et certaines associations de femmes autochtones ou afro-colombiennes ont dénoncé leur exclusion des discussions stratégiques et l’invisibilisation de leur vécu spécifique (déplacement forcé, spoliation de terres, violences racialisées).
Ainsi, penser les effets globaux de la Résolution 1325 à travers le prisme de l’intersectionnalité ne revient pas à en nier l’importance, mais à en approfondir la portée critique : pour que « femmes, paix et sécurité » ne soient pas des slogans universels vidés de leur substance, mais bien les fondements d’une paix juste, inclusive, et ancrée dans la diversité des expériences vécues.
II/ Vingt-cinq ans après : entre effets de vitrines et avancées fragiles
Un quart de siècle après l’adoption de la Résolution 1325, l’ambition de construire une paix durable en intégrant pleinement les femmes dans les processus de sécurité reste largement inachevée. Si l’on observe indéniablement certaines avancées — notamment en termes de visibilité institutionnelle et d’élaboration de cadres juridiques et politiques — ces progrès demeurent, dans bien des cas, symboliques ou fragmentés. Les données disponibles révèlent des améliorations quantitatives timides, parfois déconnectées de changements qualitatifs réels dans les dynamiques de pouvoir. Par ailleurs, les obstacles structurels qui entravent une mise en œuvre pleine et effective de l’agenda « Femmes, paix et sécurité » sont nombreux : manque de financements, absence de mécanismes contraignants, résistances politiques ou encore instrumentalisation des enjeux de genre à des fins diplomatiques.
Cette partie analysera d’abord les résultats tangibles obtenus depuis 2000 (A), avant d’identifier les limites profondes qui continuent de freiner la réalisation concrète des objectifs portés par la Résolution 1325 (B).
A. Des progrès mesurables mais insuffisants
Depuis 2000, des avancées concrètes ont été réalisées dans la reconnaissance formelle du rôle des femmes dans les processus de paix et de sécurité. Des mécanismes institutionnels ont été créés au sein de l’ONU pour intégrer la dimension de genre dans les missions de terrain, avec la nomination de conseillers en genre, la formation des Casques Bleus à la prévention des violences sexuelles, ou encore la création de postes de représentants spéciaux du Secrétaire général chargés des violences sexuelles dans les conflits. Dans certaines opérations de maintien de la paix — comme en République centrafricaine (MINUSCA) ou en République démocratique du Congo (MONUSCO) — des unités spécialisées ont été mises en place pour répondre aux besoins spécifiques des femmes, tant en matière de protection que de participation.
Sur le plan statistique, on observe également une lente amélioration de la représentation des femmes dans les missions de l’ONU : leur proportion dans les contingents militaires reste faible (environ 6 % en 2023), mais elle est plus élevée dans les composantes civiles et policières, notamment dans les fonctions de médiation, de formation ou de liaison communautaire. De même, certains processus de paix ont intégré des quotas de participation féminine ou des commissions de genre, comme ce fut le cas au Yémen (2013), en Colombie (2016), ou au Soudan du Sud (2018).
Toutefois, ces avancées restent largement en deçà des ambitions initiales. Le rapport du Secrétaire général de 2024 note que les femmes représentent toujours moins de 13 % des médiateurs, 6 % des signataires d’accords de paix, et 7 % des négociateurs principaux dans les processus de paix soutenus par les Nations Unies. Ces chiffres, quasi inchangés depuis une décennie, traduisent une stagnation inquiétante. La participation féminine, quand elle existe, est souvent cantonnée à des rôles consultatifs ou périphériques, sans pouvoir décisionnel réel. Par ailleurs, les processus de paix où les femmes ont été présentés de manière significative demeurent l’exception, et non la norme.
Enfin, la nature même de certains progrès interroge : dans plusieurs cas, la présence de femmes est utilisée pour légitimer des processus déjà verrouillés, sans véritable impact sur le contenu des négociations. Ce phénomène, parfois qualifié de « gender tokenism », réduit la participation féminine à une case à cocher, au détriment d’une inclusion substantielle. Les forums internationaux affichent souvent une parité formelle qui masque une absence de transformation des rapports de pouvoir. Ainsi, si la Résolution 1325 a bien permis d’introduire une culture du genre dans les institutions de paix, cette culture demeure trop souvent décorative, plus performative que transformatrice.
B. Des obstacles persistants à la pleine application
Ce phénomène de gender tokenism – ou participation de façade – constitue l’un des angles morts les plus critiques de la mise en œuvre de la Résolution 1325. Il se manifeste lorsque la présence de femmes dans les processus de paix est mobilisée à des fins d’image ou de conformité politique, sans que ces femmes disposent d’un réel pouvoir d’influence sur les décisions. Dans le cadre des pourparlers de paix en Afghanistan (2010–2020), par exemple, les femmes afghanes invitées aux tables de négociation étaient souvent sélectionnées par des acteurs internationaux selon des critères de respectabilité ou de proximité idéologique, et non par des critères objectifs de sélection. Certaines d’entre elles n’avaient pas de mandat représentatif et n’étaient pas consultées sur les lignes rouges des discussions, leur présence servant davantage à légitimer le processus aux yeux de la communauté internationale.
De même, lors du Forum national de réconciliation au Mali (2017), si plusieurs femmes ont été mises en avant dans la communication institutionnelle, leur participation effective aux commissions de travail s’est révélée marginale, et aucune n’a été associée à la rédaction finale des recommandations stratégiques. Des témoignages recueillis par l’ONG Femmes Africa Solidarité ont montré que certaines avaient été informées de leur participation seulement quelques jours avant, sans préparation ni capacité d’intervenir de manière structurée. Autre exemple emblématique : dans les processus de réconciliation au Myanmar, notamment en 2018–2019, les femmes issues des minorités ethniques ont été systématiquement reléguées à des groupes de discussion parallèles, tandis que les décisions majeures étaient prises par des élites masculines dans les enceintes officielles.
7
Si l’architecture normative de la Résolution 1325 est désormais bien établie, sa mise en œuvre effective demeure entravée par une série d’obstacles structurels, qui relèvent autant des logiques institutionnelles que des rapports de pouvoir profondément enracinés. Le premier frein est d’ordre financier : malgré les engagements politiques répétés, les moyens alloués à l’agenda « Femmes, paix et sécurité » restent dérisoires. Le rapport de 2024 rappelle que moins de 1 % du financement global consacré aux processus de paix est dirigé vers des initiatives intégrant l’égalité de genre. Dans de nombreux pays, les Plans d’action nationaux sont adoptés sans budget dédié, réduisant leur portée à des déclarations d’intention sans leviers d’action réels. Ce sous-financement chronique affecte particulièrement les organisations féminines locales, qui manquent de ressources pour participer de manière autonome et durable aux processus de reconstruction.
Dans le cadre de la transition en République démocratique du Congo, plusieurs femmes leaders de la société civile ont dénoncé le fait que leur présence était tolérée tant qu’elle restait apolitique ou symbolique, mais fortement découragée dès lors qu’elles formulent des revendications touchant aux réformes de fond, comme la justice transitionnelle ou la réforme du secteur de la sécurité. Cette hostilité peut prendre des formes ouvertes (menaces, délégitimation publique), mais aussi des formes plus insidieuses : marginalisation dans les prises de décision, absence d’accès à l’information stratégique, ou non-reconnaissance des compétences.
Par ailleurs, l’absence de mécanismes contraignants dans le dispositif institutionnel de la Résolution 1325 affaiblit considérablement sa capacité de transformation. Le suivi repose essentiellement sur des rapports, sans système de sanction en cas d’inaction ou de manquements flagrants. Contrairement à d’autres instruments du droit international (comme les traités relatifs aux droits de l’homme), la Résolution 1325 n’est pas juridiquement opposable, ce qui permet à certains États de se réclamer de son esprit tout en poursuivant des politiques contradictoires. Cette impunité politique est aggravée par le manque de cohérence des institutions internationales elles-mêmes : ainsi, certains pays membres du Conseil de sécurité promeuvent la parité dans les discours, tout en soutenant des régimes ou des groupes armés qui bafouent les droits fondamentaux des femmes dans les faits.
Enfin, les dynamiques géopolitiques contemporaines tendent à reléguer les enjeux de genre à l’arrière-plan des priorités sécuritaires. Dans un contexte marqué par la montée de l’autoritarisme, la militarisation accrue de la diplomatie, ou les reculs démocratiques dans plusieurs régions du monde, les principes portés par la Résolution 1325 sont souvent sacrifiés au nom de la « stabilité » ou de la lutte contre le terrorisme. Cette instrumentalisation de la paix et de la sécurité aboutit à une forme de hiérarchisation des urgences, où l’égalité de genre est vue comme secondaire, voire facultative. Or, sans intégration transversale et systémique du genre dans les stratégies globales de sécurité, les initiatives portées par la Résolution 1325 resteront à la marge.
Margaux M.
notes de bas de page :
1 Nations Unies. (2024, 24 octobre). “Vingt-quatre ans après la résolution 1325, la participation des femmes dans les processus de paix stagne à 10 %, alors que les conflits les affectent de manière disproportionnée” (communiqué de presse CS/15862). https://press.un.org/fr/2024/cs15862.doc.htm
2 ONU Femmes. (2024, 22 octobre). “Guerre contre les femmes – la proportion de femmes tuées dans les conflits armés a doublé en 2023” (communiqué de presse). https://www.unwomen.org/fr/nouvelles/communique-de-presse/2024/10/guerre-contre-les-femmes-la-proportion-de-femmes-tuees-dans-les-conflits-armes-a-double-en-2023
3 Conseil de Sécurité des Nations Unies. (2008, 18 juin). Résolution 1820 (S/RES/1820) adoptée à l’unanimité.
4 Conseil de Sécurité des Nations Unies. (2009, 05 octobre). Résolution 1889 (S/RES/1889). 5 Conseil de Sécurité des Nations Unies. (2019 )
6 Ensemble des résolutions formant l’agenda “Women, peace and security” des Nations Unies. https://peacekeeping.un.org/en/women-peace-and-security-0
7 Nations Unies. (2024, 24 octobre). “Vingt-quatre ans après la résolution 1325, la participation des femmes dans les processus de paix stagne à 10 %, alors que les conflits les affectent de manière disproportionnée” (communiqué de presse CS/15862). https://press.un.org/fr/2024/cs15862.doc.htm 8Ibid.
9 Nations Unies. (2024, 24 octobre). “Vingt-quatre ans après la résolution 1325, la participation des femmes dans les processus de paix stagne à 10 %, alors que les conflits les affectent de manière disproportionnée” (communiqué de presse CS/15862). https://press.un.org/fr/2024/cs15862.doc.htm 10 Crenshaw K. (). “Démarginaliser l’intersection de la race et du sexe : une critique féministe noire de la doctrine de l’anti-discrimination, de la théorie féministe et de la politique anti-raciste”, Forum juridique de l’Université de Chicago.
11 Mouvement de paix lancé en 2003 par les femmes du Libéria de différentes religions et classes sociales qui se mobilisent de manière pacifique pour leurs droits.
12 Olonisakin, F., Barnes, K., & Ikpe, E. (2011). Women, Peace and Security: Translating Policy into Practice. Routledge.
13 Boutron, C. (2020). Faire entendre sa voix : solidarités combattantes et interventions féministes dans le processus de paix colombien. Négociations, 34(2), 63-78.