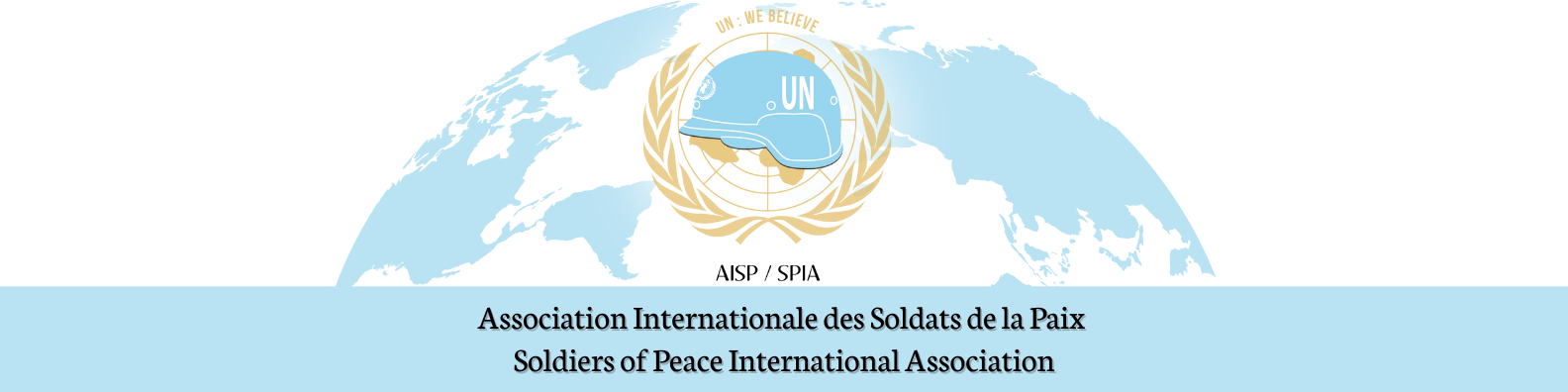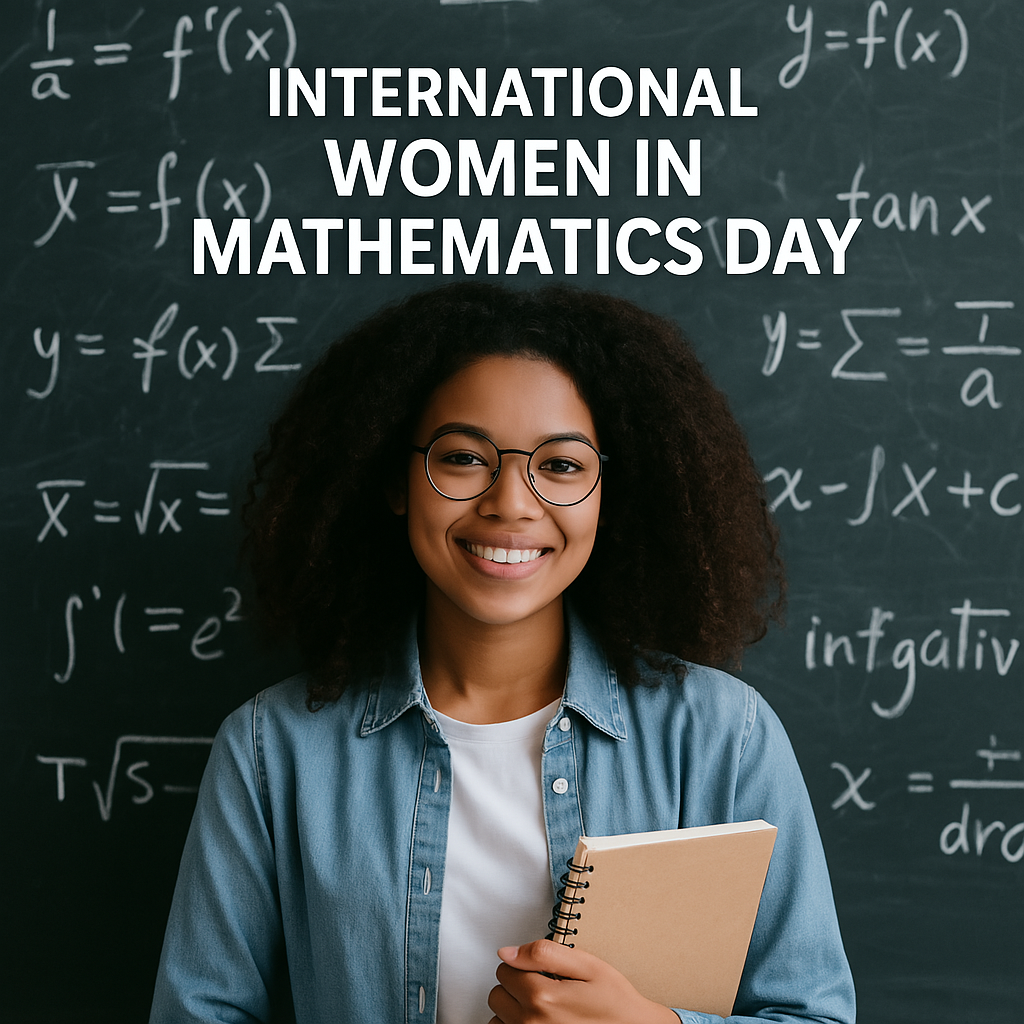Dans le cadre d’une mission de bénévolat, notre chargé de programme et référent au pôle humanitaire de l’AISP/SPIA, Ivan de Poret, a eu l’opportunité d’être présent en tant qu’observateur à la quatrième édition des Rencontres Stratégiques de la Méditerranée (RSMed), organisées par la Fondation Méditerranéenne d’Études Stratégiques (FMES). À travers cet article, nous retraçons le déroulement de ces deux journées d’échanges qui ont réuni hauts responsables militaires, politiques, diplomates et experts autour des grands enjeux de sécurité, de souveraineté et de coopération, dans l’espace méditerranéen et au-delà. Cette synthèse vise à mettre en lumière les principales orientations et réflexions stratégiques qui se dégagent de cette édition, marquée par un contexte international en recomposition.
Un rendez-vous incontournable du dialogue stratégique méditerranéen
Ces 8 et 9 octobre, le Palais des Congrès Neptune de Toulon a accueilli la quatrième édition des Rencontres Stratégiques de la Méditerranée, organisées par la Fondation Méditerranéenne d’Études Stratégiques (FMES).

Devenues un rendez-vous incontournable du dialogue stratégique euro-méditerranéen, ces Rencontres rassemblent chaque année décideurs politiques, hauts responsables militaires, diplomates, chercheurs, acteurs institutionnels et représentants de la société civile autour d’un objectif commun; celui de mieux comprendre, anticiper et répondre aux défis sécuritaires, économiques et sociétaux qui traversent l’espace méditerranéen.
Dans un contexte international marqué par la multiplication des crises; conflits de haute intensité, instabilités régionales, tensions énergétiques, rivalités d’influence et bouleversements climatiques, la Méditerranée se confirme comme un espace pivot de la sécurité et de la stabilité européenne. C’est à la croisée de ces enjeux que la FMES a souhaité placer cette édition 2025, consacrée à la nécessité de réarmer la pensée stratégique et de renforcer la résilience collective face aux crises de demain.

La FMES: Une école de la pensée stratégique méditerranéenne
Créée en 1989 et basée à Toulon, la Fondation Méditerranéenne d’Études Stratégiques (FMES) s’impose aujourd’hui comme un acteur central de la réflexion stratégique française et euro-méditerranéenne. Reconnue d’utilité publique, la FMES a pour mission de former, analyser et anticiper les grandes évolutions du bassin méditerranéen, en rassemblant les mondes académique, institutionnel, militaire et économique autour d’une même ambition: “comprendre pour mieux agir”.

À travers ses programmes de formation, ses publications et ses événements, la FMES contribue activement à diffuser une culture stratégique auprès des décideurs publics et privés. Elle œuvre également à renforcer la compréhension mutuelle entre les rives nord et sud de la Méditerranée, en favorisant le dialogue, la coopération et la mise en réseau des acteurs régionaux. Cette vocation en fait un lieu privilégié d’échanges entre les sphères civiles et militaires, où se construit une vision commune des enjeux de sécurité, de développement et de souveraineté.
Forte de son ancrage à Toulon, siège de la principale base navale française, la FMES s’inscrit au cœur des réalités géostratégiques de la région. Par son approche transversale, elle participe à la construction d’une pensée stratégique méditerranéenne, indispensable à la stabilité et à la paix durable.
Les objectifs de la rencontre: Réarmer la pensée et renforcer la résilience
Face à un environnement international marqué par la multiplication des crises; guerre en Ukraine, instabilité au Sahel, tensions énergétiques et rivalités d’influence, la Méditerranée demeure un espace de fragilité mais aussi d’opportunités.
C’est dans ce contexte que la 4ᵉ édition des Rencontres Stratégiques de la Méditerranée mêle perspectives opérationnelles, académiques et technologiques afin de réarmer la pensée stratégique et renforcer la résilience face aux crises de demain. Cela traduit une volonté claire, celle de redonner à la réflexion stratégique sa place centrale afin de comprendre les dynamiques contemporaines, et ce, tout en formant les jeunes générations à décrypter un monde en profonde mutation.
Les Rencontres visent ainsi à croiser les expertises et à stimuler le dialogue entre décideurs, dans l’objectif de favoriser une approche intégrée des enjeux méditerranéens. Plus qu’un simple espace de débat, elles constituent un laboratoire d’idées et de coopération, où se construisent des passerelles entre la réflexion stratégique et l’action opérationnelle.
Au-delà de l’analyse géopolitique, cette édition 2025 met un accent particulier sur la résilience des sociétés méditerranéennes, leur aptitude à s’adapter, à innover et à affronter collectivement les défis de notre temps. Elle vise également à redonner à ces sociétés une place centrale sur la scène internationale, en évitant qu’elles ne soient reléguées au rang de spectatrices dans un monde structuré par la compétition entre grandes puissances. Les échanges ont ainsi cherché à dégager des pistes d’action concrètes pour anticiper les crises, renforcer la stabilité régionale et raviver l’esprit de solidarité, dans une logique de responsabilité partagée.
La conférence d’ouverture: Vers une pensée stratégique européenne

La conférence d’ouverture a donné le ton de cette quatrième édition. Dans une salle comble, le directeur général de la FMES, Pascal Ausseur, offre une analyse lucide du contexte international actuel, marqué selon lui par le retour de ce qu’il appelle le “darwinisme géopolitique”.
Dans ce monde où les rapports de force prennent le pas sur les principes, la survie et la puissance deviennent les moteurs essentiels des relations internationales. Loin des illusions d’une mondialisation régulée ou d’un ordre international stable, les États renouent ainsi avec une logique de compétition, où seuls ceux qui savent penser, s’adapter et agir avec clairvoyance peuvent préserver leur indépendance ainsi que leur influence.
S’appuyant sur une lecture hobbesienne du monde contemporain, Pascal Ausseur a rappelé que nous évoluons désormais dans un environnement que Thomas Hobbes décrivait comme “l’état de nature”, c’est-à-dire un espace sans autorité supérieure, régi par la méfiance et la lutte pour la survie. Les défis récents, qu’ils soient sécuritaires, économiques ou encore technologiques, confirment cette évolution. La force, la dissuasion et la résilience deviennent alors des leviers essentiels pour garantir la paix. Face à ce constat, le directeur de la FMES a insisté sur la responsabilité particulière de l’Europe. Continent de droit, de dialogue et de valeurs, “l’Europe ne peut plus se permettre de subir les rapports de puissance, elle doit redevenir un acteur stratégique à part entière capable d’assumer ses choix, de défendre ses intérêts et d’affirmer une autonomie de pensée mais aussi d’action”. Ce retour du réalisme géopolitique n’implique pas la renonciation à ses idéaux, mais au contraire la nécessité de les protéger activement, en conjuguant puissance, solidarité et lucidité.
Ainsi, “nous vivons un moment décisif où l’Europe n’a plus le luxe de l’attentisme”. Elle doit choisir entre l’affirmation de son autonomie stratégique ou le risque d’une marginalisation durable. Il ne s’agit plus d’observer le monde se transformer, mais de saisir ce moment pour agir, avant que les dynamiques géopolitiques ne se figent sans elle. Face à cette mutation, Pascal Ausseur lance alors une invitation à la lucidité: “Pour s’adapter, il faut réfléchir”
La journée du 8 octobre: Débats et analyses autour des défis contemporains
La première journée des Rencontres Stratégiques de la Méditerranée 2025 a illustré toute la richesse intellectuelle et la diversité des thématiques abordées, témoignant de la volonté de la FMES d’articuler les enjeux de puissance, de gouvernance et de résilience au sein d’un même espace.
Les tables rondes successives ont ainsi permis de confronter des approches complémentaires, technologiques, géopolitiques et sociétales, autour de grands questionnements contemporains. Le rôle croissant de l’intelligence artificielle dans les stratégies de défense, les dynamiques religieuses et reconfigurations politiques en Afrique, ou encore les ambitions des États du Golfe dans un ordre régional en redéfinition.
Cette pluralité nous permet de penser la Méditerranée dans toute sa complexité, en intégrant à la fois les transformations militaires et technologiques, les mutations identitaires et religieuses, et les positionnements diplomatiques des puissances régionales.
Parmi ces nombreuses discussions, trois échanges ont particulièrement retenu notre attention, tant par la pertinence de leurs analyses, qu’en raison de la convergence de leurs thématiques avec les missions de notre association.
Réarmer les esprits: la jeunesse face aux défis du monde contemporain
Cette table ronde consacrée à la jeunesse a proposé un changement de focale, en abordant la sécurité non plus seulement sous l’angle géopolitique, mais également sous celui de la vigilance intellectuelle et citoyenne.
Réunissant notamment Gildas Leprince (alias Geopolitix), Muriel Domenach (diplomate), Sarah M’Roivili (étudiante Science Po) et Claire Daudé (étudiante Science Po), les échanges ont mis en évidence la nécessité de redonner à la jeunesse les outils de compréhension, d’analyse et de discernement indispensables à la construction d’une société lucide et ouverte sur le monde. “La force d’une nation ne réside pas dans ses murailles, mais dans le caractère de ses citoyens”, a rappelé la diplomate de carrière Muriel Domenach. Soulignant ainsi l’importance de la formation, du sens critique et de l’engagement civique dans un contexte de désinformation constant à l’ère de l’ultra-connectivité. Les intervenants ont également évoqué le mal-être d’une génération confrontée à la surinformation et à la perte de repères: “vingt pour cent des jeunes de dix-sept ans ont déjà souffert de troubles dépressifs”, a rappelé la jeune Claire Daudé, étudiante à Science Po Menton.
Pour l’AISP/SPIA, ce réarmement intellectuel et moral rejoint pleinement l’idée que la paix se construit d’abord par la connaissance et la compréhension mutuelle, avant même la diplomatie ou la force et qu’il est primordial de donner à cette génération la capacité de demeurer ouverte à l’international, tout en ayant le recul nécessaire à la préservation de leur santé mentale et de leur esprit critique
Une nouvelle donne stratégique au Levant: entre rivalités et incertitudes
Le panel consacré au Levant a permis de dresser un tableau saisissant des recompositions régionales à l’œuvre. Les intervenants; le Colonel Guirec Fauchon (DGRIS), Pierre Razoux (FMES), Joost Hiltermann (International Crisis Group), Léa Landman (Géopolitologue) et Dr Nicolas Badaoui (professeur Institut Sciences politiques), ont mis en lumière une région en restructuration permanente. Un espace où s’effritent les anciennes alliances et où de nouveaux acteurs, tels que la Turquie, l’Égypte ou le Qatar, s’imposent comme puissances d’équilibre.
Les États-Unis quant à eux, tout en réduisant leur empreinte militaire, cherchent à maintenir leur influence à travers la diplomatie économique et la relance du dossier palestinien. Tandis que la Syrie demeure un territoire incertain, oscillant entre reconstruction et fragmentation. Selon Pierre Razoux, “le Levant demeure un révélateur de toutes les fractures du Moyen-Orient: religieuses, politiques et identitaires.” Ce diagnostic a été prolongé par Joost Hiltermann, pour qui la région vit une “restructuration du chaos”, davantage qu’une stratégie coordonnée.
Derrière ces logiques de puissance, les intervenants ont souligné le rôle déterminant des enjeux humains et sociaux, reconstruction, avenir des minorités, gestion de l’eau, comme conditions d’une paix durable. Ces analyses rejoignent les préoccupations de l’AISP/SPIA, pour qui la stabilité régionale ne peut être envisagée sans rétablir le lien entre diplomatie, développement et coopération civile et militaire.
L’Europe sous pression: puissance, lucidité et responsabilité
Enfin, la table ronde sur la défense européenne a offert une perspective plus structurelle, questionnant la capacité du continent à affirmer sa puissance dans un monde qui se fragmente.
Les intervenants, Philipp Burkhardt (KAS), l’Ambassadrice Nathalie Chuard (DCAF), Tuija Karanko (PIA) et Frédéric Pierucci (Ikarian conseil), ont mis en évidence la nécessité d’une dissuasion crédible, d’une coopération industrielle renforcée et d’une cohésion politique renouvelée. Par ailleurs, “Sans autonomie stratégique vis-à-vis des États-Unis, l’Europe ne sera jamais souveraine”, a averti Frédéric Pierucci, fondateur du cabinet de conseil Ikarian. Synthétisant ainsi une préoccupation partagée par l’ensemble des participants.
Ces réflexions ont trouvé un écho particulier dans le témoignage du grand témoin de cette journée, Pierre Vimont, diplomate de carrière, ancien ambassadeur de France auprès de l’Union Européenne et premier secrétaire général du Service Européen de l’Action Extérieur (SEAE). “L’Europe, jadis moteur visionnaire sous l’impulsion de Jacques Delors, peine aujourd’hui à définir une ligne claire entre désenchantement politique, montée des populismes et sentiment d’impuissance collective”. Son appel à une diplomatie “lucide, unie et assumée” a marqué les esprits par sa justesse et son réalisme. Il invite également à dépasser le récit idéalisé d’une Europe strictement vertueuse pour renouer avec une réalité de puissance et de responsabilité, adaptée à un monde de rapports de force.
Trois chefs d’état-major, l’unité du commandement
La journée s’est conclue sur un moment fort, la séquence conjointe des trois chefs d’état-major français: respectivement le Général d’armée Pierre Schill (Armée de Terre), l’Amiral Nicolas Vaujour (Marine nationale), et le Général d’armée aérienne Jérôme Bellanger (Armée de l’Air et de l’Espace).

Leur intervention a incarné la solidarité interarmées face à la banalisation de la violence et à la contestation du droit international. Dans un environnement marqué par provocations, contestations et affrontements, obligeant ainsi à repenser la préparation au combat.
Tous trois ont, en effet, insisté sur la nécessité d’une préparation opérationnelle adaptée à l’incertitude: renforcer la coexistence de moyens anciens et modernes, l’usage accru des drones, l’articulation entre civil et militaire. Mais également d’une “agilité” stratégique et d’une coopération renforcée à l’échelle européenne et régionale. “Notre cohésion reste notre meilleure force”, ont-ils rappelé. Soulignant que la sécurité européenne ne peut être pensée que dans la solidarité des forces et la convergence des volontés, “Les armées gagnent les batailles, ce sont les nations qui gagnent les guerres”.
La journée du 9 octobre: Adaptation, puissance et souveraineté face aux nouvelles conflictualités
La deuxième journée des Rencontres Stratégiques de la Méditerranée 2025 s’est ouverte sur une réflexion d’ensemble autour des mutations de la guerre et de la puissance à l’œuvre au XXIe siècle.
Les multiples tables rondes ont mis en lumière la transformation des rapports de force internationaux et les défis que doivent relever les puissances méditerranéennes et européennes afin de préserver leur souveraineté. Les débats ont abordé une large gamme de thématiques: les guerres hybrides et la désinformation comme nouvelles armes géopolitiques, les recompositions d’influence dans les Balkans et le Caucase, les rivalités de puissance entre États-Unis, Chine, Russie et Union européenne, ou encore la place de la France dans un ordre multipolaire en recomposition. D’autres échanges ont exploré les domaines émergents de la conflictualité, tels que l’espace, désormais devenu un véritable théâtre stratégique, ou encore la sécurisation du commerce maritime mondial, condition essentielle de la stabilité économique internationale.
Cette diversité thématique a permis de dresser un état des lieux global des défis de défense et de sécurité dans un environnement en mutation, où la compétition des puissances se mêle à l’enchevêtrement des menaces.
Les guerres hybrides et la désinformation: la guerre avant la guerre
Les panels consacrés aux guerres hybrides et à la désinformation ont mis en évidence la montée de formes de conflictualité dites “sous le seuil”, mêlant cyberattaques, sabotage, influence informationnelle et manipulation des récits.
Comme l’a rappelé Didier Piaton (chercheur associé FMES), “l’hybridité consiste à utiliser l’espace commun pour établir un rapport de force non revendiqué, sans franchir le seuil de la guerre ouverte”. Cette stratégie, difficilement attribuable, brouille ainsi la frontière entre paix et guerre, et remet en cause les cadres classiques du droit international. Hugues Foulon, directeur exécutif d’Orange Cyberdéfense, a souligné que ces attaques “protéiformes” visent avant tout à “gagner la guerre avant de la faire”, en affaiblissant la résilience des sociétés et la confiance dans les institutions.
Cette idée a été prolongée dans la table ronde sur la désinformation, où Marie-Doha Besancenot (Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères) a rappelé que “la manipulation de l’information n’est plus un instrument de propagande, elle redessine les équilibres diplomatiques”.
Des exemples concrets, Ukraine, Moyen-Orient, Afrique ont montré comment la désinformation sert aujourd’hui à justifier des interventions, influencer les opinions et déstabiliser les États.
L’amiral Pierre Vandier: “Adapt or die”
Moment marquant de cette deuxième journée, l’intervention de l’Amiral Pierre Vandier, Commandant suprême allié Transformation de l’OTAN, a donné une résonance stratégique à l’ensemble des débats.
Dans son allocution intitulée “Combattre à 32 dans un monde chaotique”, il a souligné la rapidité de transformation du monde contemporain et la nécessité pour l’Alliance atlantique comme pour l’Europe de s’adapter sans délai. “Ceux qui vont survivre sont ceux qui s’adaptent”, a-t-il affirmé, dénonçant la fragmentation du marché européen de la défense et appelant à une cohérence industrielle et technologique qui replace le soldat “sur le cheval de la tech”.
L’amiral a insisté sur le défi de la souveraineté numérique et spatiale, estimant que la révolution initiée par SpaceX oblige l’Europe à investir pleinement ces nouveaux champs de puissance. Pour lui, “le risque d’être en retard est désormais plus grave que celui de se tromper”. L’heure n’est donc plus à la prudence, mais à l’action collective, à l’innovation et à la prise de risque stratégique. Sa conclusion, brève et percutante, “Adapt or die”, résume l’esprit de cette édition. Dans un monde de rupture, l’adaptation est devenue la condition même de la survie des puissances.
Clôture et conclusions: Penser, agir et coopérer face à l’urgence stratégique
Ainsi, cette édition des Rencontres Stratégiques de la Méditerranée confirme le rôle central de la FMES comme espace de réflexion, de dialogue et d’anticipation stratégique.
Durant deux journées denses, un constat commun fut dressé: le monde méditerranéen est à la croisée des chemins, confronté à des défis de puissance et de souveraineté sans précédent.
Les discussions ont révélé un triple impératif; comprendre, s’adapter et agir.
– Comprendre d’abord, car les nouvelles conflictualités, hybrides, informationnelles, économiques ou climatiques brouillent les frontières entre guerre et paix, puissance et vulnérabilité.
– S’adapter ensuite, face à un environnement technologique et stratégique où la rapidité devient une condition de survie.
– Agir enfin, collectivement, car la Méditerranée ne peut être pensée qu’à travers une coopération stratégique et solidaire, fondée sur une responsabilité commune.
Au fil des panels, un message s’est imposé; l’Europe et la Méditerranée doivent retrouver la maîtrise de leur destin. Comme l’a rappelé Pascal Ausseur, “nous sommes encore dans la période où nous pouvons agir, mais c’est le moment ou jamais”.
Cette invitation à l’action sans attendre résonne avec les multiples appels à dépasser la prudence excessive, à repenser les alliances et à renouer avec une vision stratégique à long terme. Face aux discours de résignation, la FMES a défendu une vision à la fois lucide et confiante, “la Méditerranée n’est pas un espace de fracture, mais un espace d’interdépendance”.
Ses peuples, ses sociétés civiles, ses armées et ses institutions disposent encore des ressources intellectuelles et humaines pour faire émerger une “conscience stratégique méditerranéenne”, fondée sur la connaissance mutuelle, la coopération et l’innovation.

En définitive, cette édition 2025 aura rappelé que la puissance n’est pas seulement affaire de moyens, mais de volonté et de cohérence.
“Il nous faut changer de modèle, ne plus subir la politique étrangère, mais définir et imposer la nôtre”, a conclu Pascal Ausseur, appelant à une Europe stratège et à une Méditerranée actrice de son propre avenir. Une conviction s’impose; la sécurité et la stabilité ne reposent plus uniquement sur la puissance matérielle, mais sur la qualité du lien entre les sociétés. Cette approche appelle à un véritable réarmement intellectuel, non pas au sens de la confrontation, mais comme un effort partagé de compréhension, d’analyse et de transmission.
Ainsi, penser autrement, anticiper, débattre et apprendre à agir ensemble deviennent autant de nécessités stratégiques. C’est par la connaissance, la responsabilité et la confiance mutuelle que les sociétés pourront répondre aux défis de leur temps et préserver la paix dans la durée.
Soutenant la démarche et les objectifs, l’AISP/SPIA tient à saluer l’initiative prise par la FMES. Cette quatrième édition des Rencontres Stratégiques de la Méditerranée illustre, en effet, la vocation de nos équipes à créer des passerelles entre sphères diplomatique, militaire et civile. Favoriser le dialogue entre les peuples, les institutions et les forces armées, afin de renforcer les conditions d’une paix durable.
À travers son engagement humanitaire et diplomatique, l’Association œuvre à soutenir la stabilisation des zones de crise et à promouvoir la coopération régionale comme levier de confiance et de développement. Cette vision repose sur un principe simple, mais essentiel: la paix ne s’impose pas, elle se construit
Par Ivan d.P
Sous la direction de Laurent Attar-Bayrou, Président de l’Académie Internationale de la Paix