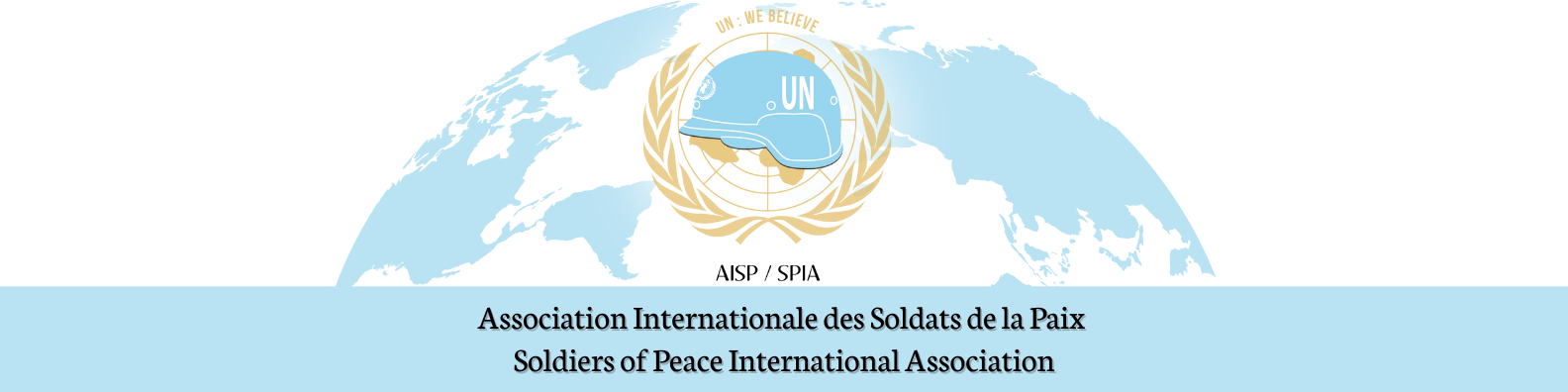Depuis avril 2023, le Soudan est entré dans une nouvelle guerre civile, la quatrième de son existance, plongeant à nouveau le pays dans une crise humanitaire et politique. Les combats opposent principalement l’armée nationale, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, aux Forces de soutien rapide (FSR) menées par Mohamed Hamdan Dagalo, dit « Hemetti ». Si Khartoum et ses environs sont devenus l’épicentre de la confrontation, le conflit s’est rapidement étendu à l’ensemble du territoire, exacerbant des fractures régionales déjà profondes et provoquant l’exode de millions de personnes.
Face à cette escalade et l’intervention de puissances extérieurs, certains pourraient y voir une guerre par procuration ou “proxy”. Selon ce point de vue , le Soudan serait avant tout le théâtre d’affrontements indirects entre puissances locales : l’Égypte soutenant l’armée régulière pour préserver un allié stratégique au sud, les Émirats arabes unis appuyant Hemetti et ses FSR dans une logique mercantile et sécuritaire, tandis que la Russie par l’intermédiaire du groupe Wagner puis de Africa Corps maintient une présence active dans l’exploitation de l’or et le soutien logistique aux FSR. Dans cette vision, l’Arabie saoudite, le Tchad et d’autres États du Sahel et de la Corne de l’Afrique interviennent également à divers niveaux, réaffirmant l’idée que le Soudan serait essentiellement un échiquier de rivalités extérieures.
Cependant, cette interprétation, bien qu’elle souligne à juste titre l’importance des interventions étrangères, tend à réduire la complexité du conflit. Elle risque d’occulter la profondeur des conflits internes soudanais : les rivalités historiques entre corps militaires et milices soutenu par l’état , la compétition pour le contrôle des ressources stratégiques, l’absence persistante de structures civiles capables d’encadrer la transition démocratique, ainsi que la dimension proprement politique des ambitions de Burhan et Hemetti, au-delà de leurs parrains extérieurs. En d’autres termes, présenter la guerre civile soudanaise comme un pur affrontement par procuration revient à minimiser la responsabilité des acteurs locaux et à sous-estimer la capacité d’agir des élites soudanaises elles-mêmes dans l’entretien et l’évolution du conflit.
Dans cet article, nous nous proposons d’explorer d’abord la nature, les objectifs et l’ampleur des interventions extérieures au Soudan, qu’elles soient militaires, financières ou diplomatiques, afin de comprendre leur rôle réel dans la dynamique du conflit. Nous critiquerons ensuite la lecture réductrice de la guerre comme un simple guerre par procuration des puissances étrangères , en montrant qu’elle tend à faire disparaître la complexité des causes du conflit , à invisibiliser la société soudanaise et à empêcher une réflexion plus fine sur les perspectives de sortie de crise.
Quels interventions extérieur dans ce conflit ?
La guerre civile soudanaise, opposant les Forces de Soutien Rapide (FSR) aux Forces Armées Soudanaises (SAF), est profondément influencée par l’ingérence d’acteurs extérieurs aux motivations politiques, économiques et stratégiques multiples. Ces interventions exacerbent le conflit en l’inscrivant dans un contexte régional et international bien plus large que la seule lutte de pouvoir soudanaise.
D’après l’Institute for the Study of War , les FSR bénéficient d’un soutien massif des Émirats Arabes Unis. Abu Dhabi envoie régulièrement armes et équipements, y compris des drones, en s’appuyant sur des hubs logistiques en République Centrafricaine, au Tchad, en Libye et en Ouganda. Ces transferts reposent sur des réseaux de trafiquants et sur l’appui de milices telles que le groupe Wagner financé par Moscou ou encore des factions libyennes comme celles de Khalifa Haftar. Les Émirats fournissent aussi à la FSR des services d’intelligence, de surveillance et de reconnaissance via l’utilisation de drones chinois basés au Tchad, et hébergent les structures administratives du groupe sur leur territoire, facilitant leurs opérations financières, logistiques et médiatiques. Ils ont même mis à disposition un jet privé pour Mohamad Hamdan “Hemedti” Dagalo, permettant à ce dernier d’effectuer des visites diplomatiques internationales, tout en recrutant des mercenaires colombiens pour combattre au Darfour.
Le soutien émirati n’est pas seulement militaire. Il répond à une stratégie d’influence plus large, fondée sur des liens politiques étroits avec Hemedti, sur le contrôle quasi-total du commerce de l’or soudanais près de 90 % des exportations légales étant destinées aux Émirats. Il faut rajouter à cela la volonté émrita d’établir des infrastructures portuaires stratégiques en mer Rouge. En ce sens, le projet avorté de construction d’un port commercial à Abu Amama, qui aurait confié 65 % des bénéfices à des entreprises émiraties, témoigne des ambitions d’Abu Dhabi. Le gouvernement SAF, aligné sur l’Égypte, a annulé cet accord en 2024, accentuant les tensions entre les deux pays.
Face à la FSR et à ses alliés émiratis, la SAF a, elle aussi, su obtenir des soutiens internationaux. L’Égypte, soucieuse de préserver ses intérêts hydropolitiques contre l’Éthiopie et d’empêcher un effondrement total du Soudan, a fourni en octobre 2023 des drones Bayraktar TB2 et entraîné des pilotes soudanais. L’Iran, de son côté, s’est rapproché de la SAF dès la fin 2023, livrant des drones Mohajer-6 multi-rôles tout en facilitant l’assemblage local de drones Zajil-3. Téhéran voit dans ce partenariat un moyen d’étendre son influence militaire vers la mer Rouge et d’y établir une base navale stratégique.
La Russie, quant à elle, oscille entre les deux camps. Après avoir soutenu les FSR via Wagner en 2023, Moscou a finalement promis en avril 2024 une aide militaire illimitée à la SAF, espérant relancer l’accord naval signé en 2017 pour construire une base en mer Rouge et développer ses projets miniers communs avec Khartoum. La Turquie complète ce tableau. Depuis août 2024, elle fournit à la SAF des drones Bayraktar TB2 et cherche à renforcer sa présence économique et militaire dans la Corne de l’Afrique, en négociant notamment le développement du port d’Abu Amama, une opportunité stratégique saisie après l’annulation du projet émirati.
Pour l’ISW , l’intensification de ces ingérences extérieures prolonge la guerre, renforce la violence des affrontements et transforme la crise soudanaise en théâtre d’affrontements géopolitiques. La rivalité émirato-turque, la compétition entre l’Iran et l’Arabie saoudite, les ambitions navales russes, ainsi que la lutte égypto-éthiopienne autour du Nil Bleu y convergent, menaçant la stabilité de la Corne de l’Afrique et de la mer Rouge, au-delà du drame humanitaire soudanais.
Un conflit aux origines avant tout locales
Réduire la guerre civile soudanaise à un simple affrontement entre acteurs soutenus par des puissances extérieures serait une lecture dans un premier temps fausse, et jouant le rôle de la désinformation autour de ce conflit. . Si ces interventions aggravent la violence, la racine du conflit se trouve avant tout dans les dynamiques politiques, sociales et territoriales internes au Soudan.
Depuis son indépendance, l’État soudanais s’est construit autour d’un pouvoir centralisé à Khartoum, dominé par les élites de la vallée du Nil, laissant les régions périphériques comme le Darfour, le Kordofan ou l’est soudanais marginalisées sur les plans économique et politique. Selon l’International Crisis Group, cette marginalisation structurelle a alimenté un ressentiment profond, tandis que le pouvoir central a systématiquement répondu par la force aux revendications régionales, plutôt que de chercher l’inclusion et la réforme
Les SAF, dirigées par le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, représentent l’armée régulière et incarnent la continuité du pouvoir au sein du Conseil transitoire de souveraineté. En face, les FSR, force paramilitaire forte d’environ 30 000 hommes, sont commandées par le vice-président du Conseil, Mohamed Hamdan Daglo, appelé aussi Hemetti. Originaires pour la plupart du Darfour, ces paramilitaires sont issus des milices Janjawid, tristement célèbres pour leur brutalité lors des conflits passés dont la guerre du Darfour . La transformation des Janjawid en RSF, sous contrôle du Service national de sécurité, a permis à Hemetti de s’ériger en acteur incontournable sur la scène militaire et politique soudanaise.
Cet accord, qui devait mener à un régime civil et pacifier le pays, n’a fait que mettre en lumière la profonde divergence des visions au sein des forces armées. Les officiers des SAF adhèrent largement à une idéologie islamiste refusant toute laïcisation, tandis que les FSR rejettent ce modèle, accusant l’armée de vouloir rétablir un régime islamo-militaire semblable à celui de l’ancien président Omar el-Béchir. Les tensions sont ainsi exacerbées par des rancunes historiques et des ambitions politiques contradictoires.
Les dimensions ethniques jouent un rôle clé dans cette rivalité. Les FSR, majoritairement composées d’Arabes du Darfour, sont en opposition avec les élites tribales arabes du nord du Soudan, notamment les Ja’alin, Danagla et Sha’iqiya, qui dominent Khartoum et l’armée régulière. Cette fracture se traduit par une hostilité mutuelle profonde : les Arabes des rivières considèrent les Arabes du Darfour comme « africanisés » et « arriérés », tandis que ces derniers, comme Hemetti, se sentent marginalisés et exclus de l’élite au pouvoir.
Historiquement, cette division remonte au régime mahdiste du XIXe siècle, où la rivalité tribale opposait déjà les Arabes de l’ouest du pays aux tribus riveraines. Plus récemment, dans les années 1980, cette rivalité s’est radicalisée avec l’influence du Rassemblement arabe, un mouvement suprémaciste appuyé par la Libye de Kadhafi, qui a alimenté des conflits fonciers et ethniques au Darfour. La rébellion des populations non arabes du Darfour en 2003 a conduit à une réaction violente du régime, qui a armé les milices Janjawid, dont Hemetti était un chef important, pour réprimer les insurgés. Ces milices ont alors commis des crimes massifs contre les populations civiles non arabes, mêlant massacres, viols et destructions.
Cette histoire explique la composition et l’identité même des FSR, qui sont perçues comme une milice ethniquement et régionalement distincte de l’armée régulière, mais aussi comme un acteur de pouvoir autonome dans l’ouest du pays. Le conflit armé actuel ne peut donc être dissocié de ces antagonismes locaux, où rivalités tribales, enjeux économiques autour du contrôle des ressources et luttes pour l’influence politique s’entremêlent.
Pour finir , la guerre entre SAF et FSR dépasse la simple lutte pour le contrôle de Khartoum. Elle cristallise des tensions ethniques et territoriales anciennes, issues d’un système politique et militaire fragmenté, où les intérêts locaux et tribaux dictent largement les alliances et les conflits. Le rejet mutuel entre ces forces armées souligne l’impossibilité d’une intégration simple, et révèle que ce conflit, s’il est national dans ses manifestations, est avant tout une guerre aux fondements profondément locaux.
En conclusion, la guerre civile soudanaise, si elle s’inscrit indéniablement dans un échiquier géopolitique régional et international, ne saurait être réduite à un simple affrontement par procuration entre puissances extérieures. Certes, les interventions étrangères qu’elles soient émiraties, égyptiennes, iraniennes, russes ou turques prolongent et intensifient la violence, tout en définissant les rapports de force militaires et économiques au Soudan. Cependant, ces ingérences n’agissent pas en substitution des dynamiques internes ; elles s’y greffent, les amplifient et les instrumentalisent.
Le conflit actuel révèle avant tout le refus d’un projet étatique soudanais inclusif, marqué depuis l’indépendance par une gouvernance centralisée et exclusive, le recours systématique à la coercition militaire et la marginalisation durable des périphéries. Les rivalités ethniques et tribales, les fractures entre élites militaires, ainsi que la compétition pour le contrôle des ressources stratégiques, notamment l’or et l’accès aux ports maritimes, structurent profondément la dynamique de cette guerre.Présenter la crise soudanaise comme une simple guerre par procuration revient ainsi à dépolitiser le conflit et à invisibiliser la société soudanaise, ses acteurs, ses résistances et ses divisions propres. À l’inverse, saisir la profondeur de ses causes est indispensable pour penser des solutions réalistes et durables. Ne pas reconnaître les causes propres au soudan , ainsi que ce qui se passe en son sein correspond à une ignorance des changements locaux et des changements poussés par les soudanais eux même.
Sitographie
https://understandingwar.org/backgrounder/sudan%E2%80%99s-civil-war-global-stakes-local-costs
https://www.revueconflits.com/lor-les-armes-et-lislam-comprendre-le-conflit-au-soudan/