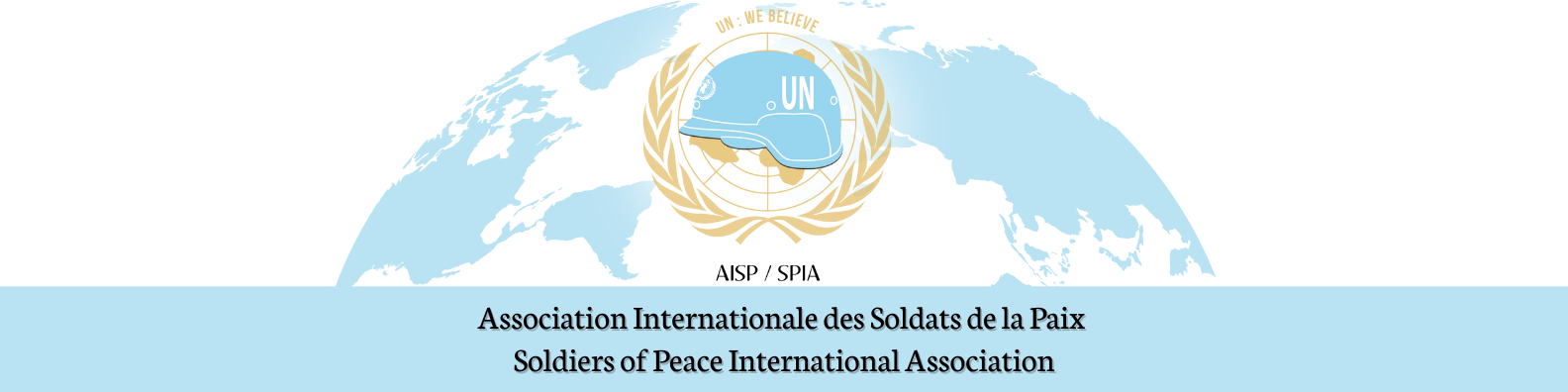La diplomatie du Vatican, bien que discrète et atypique, joue un rôle de premier plan dans les relations internationales depuis la reconnaissance officielle de la souveraineté du Saint-Siège par les accords de Latran en 1929. À travers un réseau diplomatique étendu et une autorité morale sans équivalent, le Vatican s’est imposé comme un acteur singulier, engagé sur des enjeux aussi divers que la paix, les droits de l’Homme, le dialogue interreligieux et les crises humanitaires.
Le décès du pape François en 2025 marque la fin d’une ère marquée par une diplomatie attentive aux périphéries du monde, sensible aux questions migratoires, environnementales et sociales. Avec l’élection récente de Léon XIV, premier pape étasunien de l’Histoire, le regard se tourne désormais vers l’avenir : quels prolongements ou inflexions cette transition apportera-t-elle à l’action diplomatique du Saint-Siège ? Cet article propose de revenir sur l’évolution de la diplomatie vaticane depuis 1929, en examinant ses fondements, ses moments clés et ses perspectives contemporaines.
Le Vatican, ou Cité du Vatican, situé à Rome, est le siège spirituel de l’Église catholique. Créé officiellement en 1929 par les Accords du Latran signés avec l’Italie de Mussolini, il possède une souveraineté propre, avec le pape à sa tête à la fois comme chef religieux et chef d’État. Malgré sa situation de plus petit Etat du monde (environ 44 hectares), le Vatican exerce une influence internationale importante. En effet, depuis 1964, le Vatican possède un statut d’observateur au sein de l’Organisation des Nations Unies. Il a également rejoint plusieurs autres organisations internationales importantes, comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’UNESCO ou encore l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Sa participation repose sur une volonté d’influencer les débats mondiaux autour de la paix, des droits humains, de la liberté religieuse et du développement humain intégral, tout en se gardant de soutenir des logiques de pouvoir. Ce positionnement particulier lui permet de contribuer au dialogue international sans appartenir aux blocs géopolitiques traditionnels.
La diplomatie du Saint-Siège ne repose pas uniquement sur la figure du pape, mais sur une structure institutionnelle complexe. La Secrétairerie d’État, dirigée par le cardinal Pietro Parolin depuis 2013, est l’organe central qui coordonne les missions diplomatiques, organise les négociations bilatérales et multilatérales, et supervise les nonciatures apostoliques (ambassades du Vatican). Ces nonces, souvent anciens diplomates de carrière formés à l’Académie pontificale ecclésiastique, sont essentiels pour relayer les messages pontificaux, négocier localement avec les gouvernements, et maintenir le contact avec les Églises locales. En plus de ce large réseau diplomatique on peut mentionner les relais médiatiques du Vatican comme le site Vatican news ou encore la Radio Vatican, qui émet des programmes dans une quarantaine de langue à travers le monde. Elle a émis pendant la seconde guerre mondiale ou la guerre froide et sert aujourd’hui notamment à communiquer avec les communautés catholiques isolées.
Pendant la guerre froide, la diplomatie du Vatican s’est distinguée par une position singulière, refusant de s’aligner pleinement sur la logique des blocs opposant l’Ouest capitaliste à l’Est communiste. Le Saint-Siège, soucieux de préserver son indépendance et son rôle moral universel, a adopté une posture de « troisième voie », se montrant critique à l’égard des dérives des deux camps tout en cherchant à protéger les communautés catholiques, notamment en Europe de l’Est. Sous Pie XII (1939–1958), le Vatican adopte une ligne très anti-communiste, voyant dans le marxisme une menace directe contre la foi et les libertés religieuses. Avec Jean XXIII (1958–1963), un tournant s’opère : sa célèbre encyclique Pacem in Terris (1963) appelle au dialogue entre les nations, y compris avec les régimes non démocratiques, et encourage une coexistence pacifique fondée sur la dignité humaine et les droits fondamentaux. Paul VI poursuit cette ligne en développant une « Ostpolitik » vaticane, visant à maintenir un contact diplomatique avec les régimes communistes d’Europe de l’Est pour garantir un minimum de liberté religieuse aux catholiques, notamment en Hongrie, Pologne ou Tchécoslovaquie. Mais c’est surtout le pontificat de Jean-Paul II (1978–2005) qui marque un moment décisif : pape polonais (et premier pape non-italien depuis 1523), ancien archevêque de Cracovie, il devient une figure centrale de la résistance morale au communisme. Son soutien aux mouvements dissidents, en particulier au syndicat Solidarnosc en Pologne, tout en appelant à la non-violence et au respect des droits humains, contribue à l’érosion de la légitimité des régimes de l’Est. Sa diplomatie habile, mêlant prudence institutionnelle et puissance symbolique, joue un rôle important dans les dynamiques qui mèneront à la chute du mur de Berlin et à la fin de la guerre froide.
La relation entre le Vatican et le bloc occidental a été plus complexe, marquée par une convergence stratégique sur certains enjeux — par exemple la lutte contre le communisme — mais aussi par une volonté du Saint-Siège de préserver son autonomie diplomatique et morale. Jean XXIII et Paul VI dénoncent l’impérialisme, promeuvent le désarmement nucléaire et appellent à la fin de la guerre du Vietnam.
Lors de sa visite à l’ONU en 1965, Paul VI lance un appel retentissant : « Jamais plus la guerre ! » Quant à Jean-Paul II, le pape polonais reste critique des dérives matérialistes et individualistes du capitalisme occidental. Il condamne régulièrement les inégalités économiques mondiales et appelle à une « mondialisation de la solidarité », comme en témoignent ses nombreuses interventions sur la dette des
pays du Sud et la justice sociale. Cette indépendance et cette capacité à critiquer le bloc de l’Ouest se poursuit après la fin de la guerre froide.
Si le pape reste une figure très respectée, il devient aussi une voix morale exigeante face à un monde occidental qu’il perçoit comme traversé par une crise de sens. Il se montre ainsi très critique face à ce qu’il appelle la «culture de mort », dénonçant l’individualisme, le consumérisme, la banalisation de l’avortement, de l’euthanasie ou encore la perte des repères moraux dans les sociétés libérales. Dans ses encycliques comme Centesimus Annus (1991), il reconnaît les mérites de l’économie de marché, mais avertit qu’elle ne peut être juste et humaine que si elle est régulée par des principes éthiques et une solidarité effective. Jean-Paul II critique également certains aspects de la politique étrangère des pays occidentaux, en particulier les États-Unis. Il s’oppose fermement à la guerre en Irak (2003), appelant à la résolution pacifique des conflits et dénonçant la logique de guerre préventive.
Ainsi, le Vatican s’est affirmé comme un acteur indépendant, capable de dialoguer avec tous sans renoncer à ses principes spirituels et moraux. Cette position a priori neutre a permis aux papes de participer à des négociations entre Etats, avec par exemple un rôle discret mais soutenu dans la médiation entre les États-Unis et Cuba. Dès les années 1960, le Vatican a entretenu des liens avec Cuba, facilitant un canal diplomatique indirect avec Washington. Sous le pape François, cet engagement s’intensifie : il écrit personnellement aux présidents Obama et Castro, encourageant la reprise du dialogue. Ces efforts culminent avec l’annonce en 2014 du rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays, où le rôle du Vatican est salué par les deux parties. Le pape François a parfois été décrit comme un pape de rupture par rapport à ses prédécesseurs, ce qui pose désormais la question de son héritage depuis sa disparition en 2025. Nous verrons désormais les nombreux axes qui ont caractérisé
sa stratégie internationale, en observant qu’ils s’inscrivaient souvent dans une dynamique déjà amorcée au siècle dernier.
Depuis le concile Vatican II, le dialogue interreligieux est devenu un axe majeur de la diplomatie papale. Tout a commencé avec la déclaration Nostra Aetate en 1965, qui a marqué un tournant dans les relations entre l’Église catholique et les autres religions, notamment le judaïsme et l’islam. Le pape Paul VI a posé les bases institutionnelles en créant un secrétariat pour le dialogue avec les non-chrétiens, ce qui a été poursuivi et renforcé par Jean-Paul II. Ce dernier a multiplié les gestes forts, comme sa visite à la synagogue de Rome (1986), à une mosquée en Syrie (2001), ou encore l’organisation de la rencontre interreligieuse d’Assise pour la paix. Il visite Israël et les Territoires palestiniens en 2000, prie au mur des Lamentations, se rend au mémorial de la Shoah (Yad Vashem), et exprime la souffrance du peuple juif tout
en rappelant les droits du peuple palestinien à un État indépendant. Il insiste sur Jérusalem comme lieu de coexistence des trois grandes religions monothéistes, dont le statut doit être respecté dans un cadre international. Enfin, le pape François a donné une nouvelle ampleur à cette dynamique, notamment avec la signature du « Document sur la Fraternité humaine » avec le Grand Imam d’Al-Azhar en 2019, et la
publication de l’encyclique Fratelli tutti. À travers ces initiatives, les papes ont cherché à construire des ponts entre les religions et à promouvoir une culture du dialogue, du respect et de la paix dans un monde de plus en plus marqué par les divisions.
Le Vatican s’engage aussi pour l’environnement depuis les années 1990. Jean-Paul II souligne la responsabilité humaine dans la protection de l’environnement et met en garde contre la surexploitation des ressources naturelles dans Centesimus Annus (1991). Benoît XVI, surnommé le « pape vert », renforce cet engagement en installant des panneaux solaires au Vatican et en promouvant une « écologie humaine ». Avec le pape François, l’écologie devient une priorité explicite.
En 2015, il publie l’encyclique Laudato Si’, condamnant la consommation illimitée, la destruction de la biodiversité et le changement climatique. Il prône une écologie intégrale, liant respect de la nature, justice sociale et spiritualité, et appelle à un changement radical de modèle basé sur la sobriété et la solidarité. François intervient régulièrement lors des conférences climatiques (COP), soutenant les Accords de Paris, dialoguant avec des figures comme Greta Thunberg et critiquant l’inaction des gouvernements. En 2023, il publie Laudate Deum, critiquant sévèrement les intérêts économiques freinant la transition écologique.
Sous le pontificat du pape François, la relation entre le Vatican et le Sud global a également pris une ampleur inédite, marquée par une attention constante aux périphéries géographiques, sociales et existentielles du monde contemporain. Premier pape issu du Sud, François inscrit sa diplomatie dans une perspective postcoloniale. Dans Evangelii Gaudium (2013), il dénonce un « système économique qui tue » et met l’accent sur les réalités des périphéries — inégalités, migrations, exploitation. Ses voyages dans des régions marginalisées (Afrique, Asie du Sud-Est) visent à soutenir la justice sociale et le dialogue interreligieux. Dans Laudato Si’, il insiste sur le lien entre changement climatique et vulnérabilité des pauvres, appelant à une conversion écologique et solidaire.
Cependant, cette diplomatie des périphéries suscite parfois des tensions. Certaines conférences épiscopales (en Afrique ou en Europe de l’Est) critiquent ses positions sur l’écologie ou les migrations. La stratégie envers la Chine — acceptantque Pékin propose des évêques — a été vivement contestée, notamment par le cardinal Zen à Hong Kong, qui y voyait une concession dangereuse.
Enfin, au sein des enceintes internationales comme l’ONU, le Vatican défend une vision holistique des droits humains. Il plaide pour la protection des enfants, des migrants et des minorités religieuses. L’archevêque Gabriele Caccia, représentant du Saint-Siège, rappelle que la migration est une réponse naturelle aux crises et condamne le racisme comme un affront à la dignité humaine. François, quant à lui,
promeut une approche de l’accueil des migrants fondée sur quatre principes : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Surtout il appelle sans cesse à la fin des différents conflits qui marquent son pontificat, en Ukraine ou en Palestine par exemple.
Cependant, cette posture éthique conduit parfois à des malentendus diplomatiques. Ainsi, dans le contexte de la guerre en Ukraine, les appels du pape à la paix — et notamment à un « courage du drapeau blanc » — ont été interprétés comme un appel à la capitulation, suscitant l’irritation de Kiev et de ses alliés.
Malgré l’image d’arbitre moral et de médiateur discret que cultive le Saint-Siège, sa diplomatie n’échappe en effet pas aux critiques. Certains analystes soulignent un manque de transparence dans ses processus décisionnels, liés à l’opacité de la Curie romaine et à l’absence de contre-pouvoirs institutionnels. Plus largement, dans un monde traversé par de profondes mutations sociales, écologiques et spirituelles, le Vatican est parfois perçu comme en décalage, notamment par les jeunes générations ou dans des contextes fortement sécularisés, alors que l’Église est confrontée à des scandales internes et des tensions entre courants opposés sur certains sujets.
En conclusion, depuis les accords de Latran en 1929, la diplomatie du Vatican s’est construite sur un équilibre délicat entre engagement spirituel et intervention sur la scène internationale. Acteur singulier par sa taille mais influent par son autorité morale, le Saint-Siège s’est illustré par une posture indépendante, souvent critique face aux logiques de pouvoir, et soucieuse de promouvoir la paix, les droits humains, le dialogue interreligieux et la justice sociale. Du refus des blocs durant la guerre froide à l’essor du dialogue interreligieux après Vatican II, en passant par son rôle dans les crises contemporaines, le Vatican a su faire entendre une voix éthique, souvent dissonante mais respectée. À l’heure où le pape Léon XIV prend la tête de l’Église, les interrogations sont nombreuses quant aux orientations futures de cette diplomatie unique. Entre continuités et renouvellements, l’action internationale du Saint-Siège continuera sans doute à refléter une quête de justice globale, fondée sur des principes spirituels. Cette mission se heurte toutefois à des défis majeurs : recul de la pratique religieuse en Occident, scandales et tensions internes, montée des nationalismes, et essor de régimes autoritaires attendent des réponses claires de l’Église dans un monde en mutation, si elle souhaite conserver son influence unique dans le monde.
Maxime D.
Sous la direction de Laurent Attar-Bayrou, Président de l’Académie Internationale de la Paix
Bibliographie :
Articles de revue :
Blakemore, William B. 2025. « St. John Paul II – Interfaith Dialogue, Ecumenism, Papal Visits | Britannica ». Britannica, juin. https://www.britannica.com/biography/Saint-John-Paul-II/Dialogue-with-other-
faiths.
Cros, Céline. 1995. « Le Vatican et la guerre froide ». Matériaux pour l’histoire de notre temps, n o 3738, 4849. https://doi.org/10.3406/mat.1995.402743.
Mabille, François. 2004. « Les confins dans la politique internationale du Vatican ». Revue d’études comparatives Est/Ouest 35 (4): 12747. https://doi.org/10.3406/receo.2004.1680.
Mabille, François. 2023. « Relations internationales et géopolitique du Saint Siège sous Benoît XVI ». IRIS, janvier. https://www.iris-france.org/172592-relations-internationales-et-geopolitique-du-saint-siege-sous-benoit-xvi-2/.
Articles de presse :
Burger, John. 2023. « Deporting Immigrants? Vatican Rep Speaks at UN ».
Aleteia. 11 octobre 2023. https://aleteia.org/2023/11/10/deporting-immigrants-
vatican-rep-speaks-at-un/.
CNA. s. d. « Cuba, US: How the Holy See Was behind the Scene for 50 Years ». Catholic News Agency. Consulté le 30 juin 2025. https://www.catholicnewsagency.com/news/31171/cuba-us-how-the-holy-see-
was-behind-the-scene-for-50-years.
Courrier international. 2025. « François, un pape “contradictoire” et “ambivalent” sur la guerre en Ukraine », 22 avril 2025, sect. Société. https://www.courrierinternational.com/article/francois-un-pape-contradictoire-et-ambivalent-sur-la-guerre-en-ukraine_230143.
Farriol, Guillaume. 2025. « La cause environnementale, un fil rouge du pontificat de François ». Radio France, 22 avril 2025. https://www.franceinfo.fr/replay-radio/le-billet-vert/la-cause-environnementale-
un-fil-rouge-du-pontificat-de-francois_7176429.html.
Lopez, Ludivine, et Géraldine Cornet Lavau. 2019. « Vatican : entre religion et écologie depuis 50 ans | INA ». INA, 7 octobre 2019. https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/s856054_001/vatican-entre-religion-et-ecologie-depuis-50-ans.
L’Orient-Le Jour. 2003. « Jean-Paul II demande la fin rapide de la guerre », 7 avril 2003, sect. Actualités. https://www.lorientlejour.com/article/443522/Jean-Paul_II_demande__la_fin_rapide_de_la_guerre.html.
Roberts, Dan, et Kirchgaessner, Stephanie. 2015. « Pope Francis Calls for Urgent Action on Climate Change in White House Speech ». The Guardian, 23 septembre 2015, sect. World news. https://www.theguardian.com/world/2015/sep/23/pope-francis-climate-change-
white-house-speech.
Wu, Venus. 2018. « Cardinal says Vatican-China deal would put Catholics in communist cage | Reuters ». Reuters, 9 février 2018. https://www.reuters.com/article/world/cardinal-says-vatican-china-deal-would-
put-catholics-in-communist-cage-idUSKBN1FT283/?utm_source=chatgpt.com.
Source institutionnelle/primaire :
« Au Vatican, António Guterres rencontre le Pape François, défenseur de la dignité humaine et des valeurs de l’ONU | ONU Info ». 2019. https://news.un.org/fr/story/2019/12/1058661.
« Un expert de l’ONU salue le rejet par le Vatican de la « doctrine de la découverte » | ONU Info ». 2023. 10 avril 2023. https://news.un.org/fr/story/2023/04/1134072.