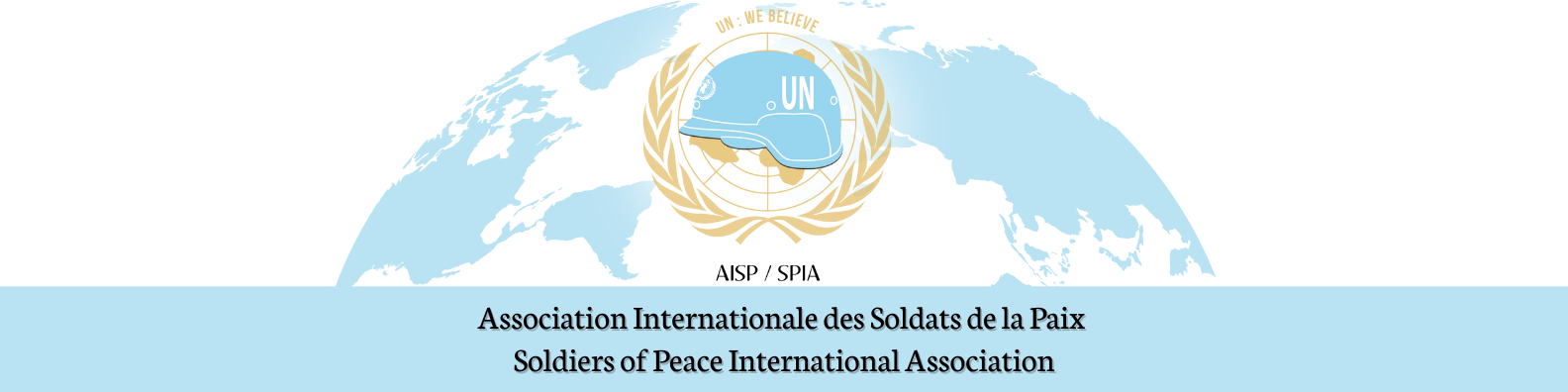Cet article vise à expliquer les origines du conflit au Cachemire entre l’Inde et le Pakistan, ainsi qu’à analyser l’approche adoptée par les Nations Unies aux origines du conflit. L’objectif est d’analyser le passé pour mieux comprendre le présent et pourquoi le contentieux n’est toujours pas réglé, et quels éléments accentuent encore les tensions.
L’État du Cachemire se trouve aux confluents de l’Inde, du Pakistan, mais également de la Chine et de l’Afghanistan. Au nord du sous-continent indien, il se révèle enjeu de convoitises géopolitiques du fait du passage de plusieurs affluents du plus grand fleuve de la région, l’Indus. Le Cachemire est aujourd’hui séparé par la « Ligne de Contrôle », le divisant en deux zones distinctes :une indienne, à l’est, et une pakistanaise, à l’ouest. La Chine, qui borde le Cachemire sur son flanc nord-est,a également annexé une partie du territoire en 1963. Celle-ci a été volontairement cédée par le Pakistan, sans que l’acte ne soit reconnu par l’Inde.
La fin de la domination coloniale britannique sur le sous-continent indien survient en 1947. Cet événement, qui demeure à ce jour demeure l’un des plus significatifs de l’histoire contemporaine, a conduit directement à la séparation de l’Inde britannique, qui n’avait pas connu l’indépendance depuis deux siècles. Sous la pression internationale et dans un climat de tensions internes grandissant, les autorités britanniques ont opté pour la séparation du territoire en deux nations distinctes : l’Inde, dominée par l’hindouisme, et le Pakistan, dominé par l’islam. Les frontières, établies sur la base de décisions arbitraires, ont inévitablement entraîné l’isolement de familles et de communautés, toutes séparées ou opposées par un tracé imaginaire. Ces conditions ont non seulement poussé les populations à fuir, mais ont également exacerbé les tensions intercommunautaires, menant alors à des massacres à grande échelle aux quatre coins du sous-continent.
L’État du Cachemire, situé au nord de la région, entra dans une crise interne dès la proclamation de la partition. Pour son dirigeant, le maharaja Hari Singh, souverain hindou d’un État à majorité musulmane, le dilemme était réel. La première option, rattacher le Cachemire à l’Inde, signifiait trahir son peuple. La seconde, rattacher le Cachemire au Pakistan, signifiait trahir ses propres convictions. La dernière option, conserver le Cachemire comme État indépendant, signifiait se retrouver coincé entre deux pays désireux de l’annexer, voire trois si l’on compte la Chine. Globalement, aucune des options ne semblait favorable. Le maharaja n’eut en réalité pas le temps de prendre une décision éclairée ; dès octobre 1947, des forces tribales soutenues par le Pakistan, puis par les troupes pakistanaises, envahirent le Cachemire dans le but de le rattacher à leur pays, craignant son rattachement à l’Inde. Le maharaja comprit rapidement qu’il ne pouvait pas défendre le territoire et demanda donc l’aide de l’Inde. Cette dernière accepta, mais à la seule condition que le Cachemire soit alors officiellement rattaché à l’Inde. La condition fut acceptée et la période interminable de conflits pour le contrôle total de la région commença entre l’Inde et le Pakistan. L’Inde et le Pakistan se sont retrouvés dans une impasse, ne trouvant ni vainqueur ni solution diplomatique, ce qui a davantage exacerbé les tensions entre les deux acteurs. Les Nations Unies, alors tout juste créées, se sont rapidement impliquées dans le sujet, espérant pouvoir trouver une solution pacifique au conflit.
Nous examinerons d’abord le rôle de médiateur des Nations Unies dans la crise du Cachemire entre 1948 et 1949. Nous analyserons ensuite les solutions proposées, leurs succès et leurs échecs, toutes marquées par des tensions persistantes, l’influence de la Guerre froide et le tracé d’une ligne de cessez-le-feu. Enfin, nous observerons l’héritage de l’intervention des Nations Unies, en explorant les répercussions de ses actions dans la région.
Vers la fin de l’année 1947, le différend entre l’Inde et le Pakistan dégénère en conflit ouvert, menaçant non seulement les deux nations, mais aussi la stabilité régionale, les pays voisins exprimant de plus en plus d’inquiétudes face à la situation. Le 1er janvier 1948, l’Inde s’est tourné vers le Conseil de sécurité, affirmant que l’ONU était le principal organisme international chargé du maintien de la paix et de la sécurité. Elle recherchait une entité impartiale détentrice d’une autorité, capable de l’aider à amoindrir la crise avant qu’elle ne s’aggrave. En saisissant le Conseil de sécurité, l’Inde cherchait une réaction immédiate pour empêcher toute nouvelle agression. Ainsi, l’Inde affirme que le Pakistan soutient l’invasion du Cachemire par des tribus armées et a demandé à l’ONU d’empêcher ses actions. L’Inde s’est également déclarée prête à organiser un plébiscite permettant aux Cachemiris de décider de leur avenir, à condition que le Pakistan retire ses forces. Face à cet appel urgent, l’ONU a décidé d’intervenir pour stabiliser la région.
L’approche des Nations Unies consistait à jouer un rôle de médiateur, à établir un cessez-le-feu et à rechercher une solution durable. Elle s’appuyait sur trois axes principaux : la création de la Commission des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan (UNCIP), la résolution 47 et son plan de paix en trois volets, et enfin un accord de cessez-le-feu. La 39e résolution des Nations Unies, adoptée le 20 janvier 1948, créait la Commission des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan (UNCIP). Son objectif était d’enquêter sur la situation et de servir de médiateur entre les deux pays afin d’éviter un conflit plus vaste. La résolution 47, adoptée le 21 avril 1948, définissait une approche en trois étapes :
L’Inde et le Pakistan ont été exhortés à cesser immédiatement les combats. Le Pakistan a été prié de retirer d’abord ses ressortissants et ses membres de tribus, puis l’Inde de réduire ses troupes et maintenir des forces minimales pour maintenir l’ordre.
De l’autre côté, les Nations Unies ont fait pression pour l’organisation d’un plébiscite auprès du peuple cachemiri afin de déterminer son avenir et de déterminer lequel des deux principaux acteurs il souhaitait rejoindre. Ce plébiscite serait supervisé par les Nations Unies afin d’en garantir l’équité et la légalité. Une telle proposition s’explique par le droit des peuples à l’autodétermination, toujours défendu par les Nations Unies. Le plébiscite était conditionnel : les conditions de retrait exposées au premier point devaient être respectées pour sa mise en œuvre.
L’établissement d’une ligne de cessez-le-feu était considéré par les Nations Unies comme une solution temporaire, définissant une frontière provisoire pour disposer de plus de temps pour discuter de la suite des événements. Cette ligne de cessez-le-feu devait être considérée comme une frontière temporaire. Grâce à la médiation des Nations Unies, un cessez-le-feu entre en vigueur le 1er janvier 1949. En raison de l’engouement suscité par ce succès, l’accord de Karachi (juillet 1949) crée le Groupe d’observateurs militaires des Nations Unies dans l’Inde et le Pakistan (GOMNUIP) pour surveiller la ligne de cessez-le-feu et prévenir toute violation. Malgré ces efforts, la pleine mise en œuvre des résolutions des Nations Unies a été compromise par de nombreux désaccords, des changements politiques et des questions de souveraineté qui ont constamment perturbé le processus de paix. Tous ces éléments ont rendu l’avenir du Cachemire incertain.
La résolution 47 n’a pas atteint ses objectifs. L’Inde et le Pakistan ont tous deux accepté l’idée d’un plébiscite, mais des désaccords sur les conditions de démilitarisation et la gouvernance du plébiscite ont alimenté les tensions. Le Pakistan a ignoré le mandat de l’ONU et a poursuivi les combats. En réponse, l’Inde a également refusé le plébiscite, arguant qu’il était impératif pour le Pakistan de retirer ses troupes afin que la résolution soit pleinement appliquée. Le pays a également refusé de réduire ses troupes, compromettant ainsi directement les efforts de l’ONU. D’un côté, l’Inde souhaitait que le plébiscite n’ait lieu qu’après une démilitarisation complète, ce qui était impossible en raison de la présence continue de forces pakistanaises et indiennes au Cachemire. De l’autre, le Pakistan a affirmé qu’il ne retirerait pas complètement ses forces tant qu’il n’aurait pas l’assurance que l’Inde respecterait les résultats du plébiscite. Plus généralement, le Pakistan, inquiet de l’influence croissante de l’Inde dans la région du Jammu-et-Cachemire, a tenté d’obtenir un rôle plus important pour les Nations Unies dans la supervision du plébiscite, mais sans succès.
Pour être clair, la période de la Guerre froide n’a pas facilité la recherche de solution et la paix. Le conflit initial, limité à l’Inde et au Pakistan, a rapidement été détourné par les acteurs importants, en particulier les États-Unis et l’URSS. Initialement favorables à un plébiscite au Cachemire, les États-Unis ont milité pour, y voyant la solution la plus démocratique, offrant l’autodétermination aux populations locales. Cependant, cette position a évolué en raison de l’intensification des tensions avec le camp communiste et les gains en popularité de la « menace rouge » en Asie du Sud. Les États-Unis ont choisi de nouer des alliances et des partenariats pour la contenir, et ont vu en le Pakistan, la possibilité de projeter leur puissance. Tout en réduisant efficacement l’influence de l’URSS dans la région, ils se retrouvent dans une situation délicate, ils soutiennent militairement le Pakistan dans le cadre d’accords de coopération comme le SEATO et le CENTO, tout en maintenant des relations diplomatiques avec la République de l’Inde. À l’autre bout du monde, l’Union soviétique, initialement neutre, s’est impliquée plus directement en tant qu’ alliée de l’Inde après les années 1950. L’URSS a usé de son droit de veto pour plusieurs résolutions de l’ONU car elles étaient perçues comme biaisées contre l’Inde. Le soutien soviétique à l’Inde permettait de contrebalancer l’alliance américano-pakistanaise et, s’il a rétabli l’équilibre dans la région, il a également contribué à la prolongation du conflit, les deux superpuissances soutenant directement leurs alliés respectifs.
Enfin, le Royaume-Uni entretenait des liens historiques avec l’Inde et le Pakistan et s’efforçait de favoriser des négociations pacifiques sans pour autant frustrer l’allié américain. Les pays du Commonwealth participaient souvent au processus de paix, mais leur influence était limitée par la dynamique de la Guerre froide. Les deux pays se sont réunis pour signer un accord de cessez-le-feu le 1er janvier 1949 sous la supervision des Nations Unies. Une ligne de cessez-le-feu fut créée et divisa officiellement la région du Cachemire en deux parties distinctes : l’Azad Jammu-et-Cachemire, à l’ouest, était sous contrôle pakistanais, tandis que le Jammu-et-Cachemire, à l’est, était sous contrôle indien. Le maintien de la ligne fut orchestré par le Groupe d’observateurs militaires des Nations Unies en Inde et au Pakistan (GOMNUIP), afin qu’un acteur impartial puisse garantir son respect. La ligne de cessez-le-feu fut tracée en respectant les positions réelles des forces indiennes et pakistanaises à ce moment-là. Les Nations Unies ne la considéraient que comme une solution temporaire, permettant seulement la stabilisation de la région et créant les conditions d’un éventuel plébiscite.
Cependant, ces projections furent de courte durée en raison de la haine mutuelle entre l’Inde et le Pakistan et de l’instrumentalisation du conflit par des puissances extérieures. Aucune alternative crédible ne fut trouvée et la ligne se solidifia au fil du temps, devenant ce que nous appelons aujourd’hui la « Ligne de Contrôle ». Ce nom fut proclamé lors de l’accord de Simla en 1972, faisant de cette ligne une frontière de facto. Une solution temporaire était désormais devenue un problème permanent, ne satisfaisant aucun des deux rivaux. Comme mentionné précédemment, les frontières étaient totalement artificielles et les deux pays ont continué à revendiquer le Cachemire comme faisant partie de leur propre territoire, estimant que l’intégration complète du Cachemire à leurs États respectifs n’était qu’une question de temps. Des escarmouches ont eu lieu et les frontières n’étaient pas vraiment respectées. Ceci, combiné à la tentative indienne de manipuler les élections locales, a conduit à une guerre en 1965, lorsque les forces indiennes et pakistanaises ont chacune décidé de franchir la frontière pour attaquer leur adversaire. Il n’y a pas eu de vainqueur clair de cette guerre, ce qui n’a fait que renforcer la division et les hostilités entre hindous et musulmans. Dans les années 1990, même après la promotion de la Ligne de Contrôle, des mouvements séparatistes ont émergé au Cachemire Indien, niant le droit de l’Inde à leur partie du Cachemire, préférant l’union avec le Pakistan ou l’indépendance. En 1999, le conflit s’est intensifié et l’Inde a pris pour cible les repaires pakistanais. En 2003, un autre cessez-le-feu a été signé pour la Ligne de Contrôle.
En clair, les tensions ne cessent de croître si bien qu’en 2019, un terroriste a tué 46 policiers indiens lors d’une attaque surprise. L’attaque a été revendiquée par le groupe terroriste Jaish-e-Mohammed, basé au Pakistan. Le Pakistan a condamné l’acte, mais l’Inde a choisi de riposter et de frapper le sol pakistanais, provoquant de nouveaux affrontements entre les deux pays, même si ceux-ci étaient de moindre ampleur. À ce jour, les tensions restent vives car le 22 avril 2025, un attentat meurtrier a été perpétré à Pahalgam, dans la région du Cachemire indien. Cette attaque a été revendiquée par The Resistance Front (TRF), un groupe terroriste affilié à Lashkar-e-Taiba, basé au Pakistan. En réaction à cette attaque, Narendra Modi, le Premier ministre indien, a même suspendu le traité de partage des eaux conclu entre l’Inde et le Pakistan, traité qui n’avait jamais été suspendu auparavant, quelle que soit l’ampleur du conflit.
La possession de l’arme nucléaire par les deux acteurs exacerbe les tensions si bien qu’après la Seconde Guerre mondiale, une course mondiale pour l’arme nucléaire s’est engagée à des fins de dissuasion. À l’instar de l’URSS contre les États-Unis, la France et du Royaume-Uni contre l’URSS, l’Inde et le Pakistan ont également compris l’importance de posséder de telles armes. C’est pourquoi, en 1974, l’Inde s’est déclarée détentrice de l’arme nucléaire. Le Pakistan mettra plus de temps à la développer, mais en 1998, il est également devenu propriétaire de la bombe atomique. La politique nucléaire de l’Inde est motivée par des menaces régionales, notamment le Pakistan, mais aussi, de plus en plus, la Chine. L’Inde applique une politique de dissuasion minimale crédible et de non-recours en premier. Le pays continue de produire des matières fissiles de qualité militaire, et son arsenal est estimé à au moins 160 ogives. L’Inde ne fait pas partie du Traité de non-prolifération (TNP) ni au Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE). Le principe directeur de la politique nucléaire pakistanaise est la dissuasion minimale crédible. Cependant, ce que le Pakistan considère comme minimal est guidé par des considérations de sécurité régionale et l’évolution des forces armées indiennes. En 2013, le Pakistan a adopté le concept de dissuasion à spectre complet afin de dissuader toute forme d’agression régionale. En résumé, le Pakistan disposerait d’un stock d’ogives nucléaires estimé à 165, soit autant que son rival. Par ailleurs, le Pakistan ne fait pas non plus partie ni du TNP, ni du TICE.
En conclusion, le sort du Cachemire semblait scellé dès l’annonce du départ britannique. Malgré les conditions favorables à une division, les tensions persistantes entre l’Inde et le Pakistan, leur incapacité à dialoguer, et l’échec du plébiscite soutenu par l’ONU ont empêché un règlement durable. La Ligne de Contrôle, censée stabiliser la région, n’a pas rempli son rôle. Aujourd’hui, la possession de l’arme nucléaire par les deux pays a aggravé une crise non résolue depuis près de 80 ans. Les récents événements rappellent l’urgence d’un dialogue direct, avec l’ONU comme médiateur.
Julien J.
Sources
- Rekacewicz, P. (1999) ‘Mosaïque ethnique au Pakistan et situation au Cachemire’, Le Monde diplomatique. Disponible sur : Mosaïque ethnique au Pakistan et situation au Cachemire, par Philippe Rekacewicz (Le Monde diplomatique, décembre 1999) (Visionné : 28/04/2025)
- ARTE (n.d.) ‘Conflit au Cachemire : les raisons de la colère’. Disponible sur : Conflit au Cachemire : les raisons de la colère | ARTE (Visionné : 28/04/2025)
- National Geographic (n.d.) ‘La Partition des Indes, l’aboutissement sanglant d’une lutte pour l’indépendance’. La Partition des Indes, l’aboutissement sanglant d’une lutte pour l’indépendance | National Geographic (Visionné : 28/04/2025)
- ‘Le Cachemire, zone géopolitique sensible’. Disponible sur : Le Cachemire, zone géopolitique sensible (Visionné : 28/04/2025)
- Herodote.net (n.d.) ‘Il y a 70 ans, la partition des Indes: un déferlement de violences’. Disponible sur : 1947 – La partition des Indes britanniques – Herodote.net (Visionné : 28/04/2025)
- E-International relations article , Westcott, S.P. (2020) The Case of UN Involvement in Jammu and Kashmir. E-International Relations, 29 May. Disponible sur : https://www.e-ir.info/2020/05/29/the-case-of-un-involvement-in-jammu-and-kashmir/ (Visionné : 28/04/2025)
- United Nations Peacekeeping webpage, United Nations (n.d.) Peacekeeping, India – Pakistan Background. Disponible sur : https://peacekeeping.un.org/mission/past/unipombackgr.html (Visionné : 28/04/2025)
- Samaa article, Samaa Web Desk (2024) UN Resolutions on Kashmir: A 78-Year Timeline of International Commitments, 26 October. Disponible sur : https://www.samaa.tv/2087323022-un-resolutions-on-kashmir-a-78-year-timeline-of-i nternational-commitments (Visionné : 29/04/2025)
- ALLAMAND, E. (2025). Inde-Pakistan : vers une guerre de l’eau ? TF1 INFO. Disponible sur :
- https://www.tf1info.fr/international/video-lci-inde-pakistan-vers-une-guerre-de-l-eau-2 368352.html (Visionné : 29/042025)