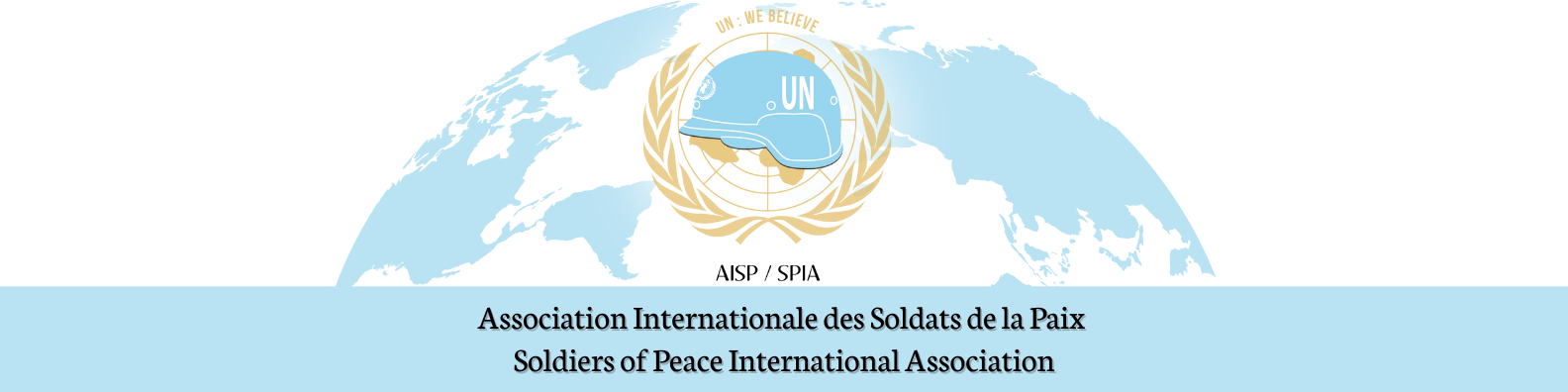Cet article a pour objectif de comprendre et retranscrire la rivalité grandissante entre deux puissances régionales du continent africain : l’Éthiopie et l’Égypte. Cette confrontation se fait majoritairement autour du Nil, plus grand fleuve africain dont l’un des deux confluents, le Nil Bleu, prend sa source en Éthiopie, avant de plonger dans le fleuve qui fait vivre l’Égypte économiquement.
Au-delà des simples querelles d’influence, les tensions ont pris une toute autre ampleur depuis l’annonce, en 2011, du projet du « grand barrage de la Renaissance » (GERD) par l’Éthiopie sur le Nil Bleu. Censé redonner sa gloire à l’Éthiopie, ce projet monumental fait trembler Le Caire, et par extension Khartoum, d’une potentielle sécheresse.
« L’eau du Nil est une ligne rouge. » Ces mots, lourds de sens, sont ceux du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Ils ont été prononcés à l’encontre des pays africains se trouvant au sud de l’Égypte, puisque nombre d’entre eux hébergent les sources du Nil, qui traverse l’Égypte du sud au nord. Plus particulièrement, ces propos s’adressaient à l’Éthiopie, qui depuis plusieurs décennies déjà prévoit la construction de son « grand barrage de la Renaissance », et dont le chantier a finalement débuté en 2011. Pour comprendre la situation, il est nécessaire d’analyser les deux points de vue : d’un côté, Égypte et Soudan craignent une réduction du débit de l’eau et les impacts potentiels sur leurs populations majoritairement concentrées le long du cours d’eau, et de l’autre, l’Éthiopie qui face à une explosion de sa démographie voit ses besoins tant en énergie qu’en production agricole grandir.
À l’heure où les tensions géopolitiques liées à la gestion des ressources naturelles se multiplient, l’eau est devenue un enjeu stratégique de premier ordre. Selon les Nations unies, plus de 2 milliards de personnes vivent déjà dans des zones de stress hydrique. Le changement climatique, la pression démographique et la surexploitation rendent cette ressource de plus en plus précieuse. Dans ce contexte mondial, le cas du Nil, deuxième fleuve le plus long de la planète, apparaît comme un exemple emblématique des conflits potentiels autour de l’eau. Ce n’est pas simplement un affrontement localisé : c’est un laboratoire des futures rivalités environnementales du XXIe siècle.
Alors, nous explorerons ces tensions interétatiques à travers les arguments égyptiens et éthiopiens, mais également en réalisant une analyse géostratégique de la région et des grands et petits acteurs qui s’y rencontrent. Nous conclurons par des projections potentielles.
Avec une construction entamée en 2011, le « grand barrage de la Renaissance » suscite rapidement les foudres égyptiennes. Le Nil traverse pas moins de 11 pays, ce qui en fait un sujet de tensions entre l’Égypte et ses voisins, tant le fleuve est précieux pour Le Caire. Déjà dans l’Antiquité, Hérodote affirmait que « l’Égypte est un don du Nil ». Ce fleuve traverse tout le pays et irrigue la bande étroite de terre fertile où s’agglomèrent l’essentiel des plus de 105 millions d’habitants du pays. Avec une pluviométrie quasi inexistante, l’eau du Nil constitue une ressource vitale pour l’agriculture, l’industrie et l’usage domestique. Pour cause, l’État dépend du Nil pour son approvisionnement en eau douce à hauteur de 95%. Dès lors, toute variation dans le débit du fleuve peut avoir des conséquences directes et potentiellement catastrophiques sur la sécurité alimentaire, l’emploi agricole, et la stabilité sociale.
La crainte égyptienne est donc existentielle. Le barrage éthiopien, dont la capacité de stockage atteint près de 74 milliards de m³, soit presque la totalité du débit annuel du Nil Bleu, représente un potentiel levier de pression, même si officiellement, l’Éthiopie affirme que le GERD ne vise qu’à produire de l’électricité. Pour l’Égypte, la question dépasse le simple usage de l’eau : il s’agit d’un enjeu de souveraineté, de sécurité, et même de survie nationale. Cela explique la fermeté du discours politique au Caire, mais aussi le recours à une diplomatie active et multilatérale visant à internationaliser le dossier.
Du point de vue éthiopien, le GERD est l’incarnation d’un rêve de puissance. Le barrage est perçu comme une œuvre de fierté nationale, financée presque exclusivement par des contributions internes, en dehors des canaux traditionnels de la Banque mondiale ou du FMI. Ce projet illustre la volonté d’Addis-Abeba de sortir de décennies de pauvreté et de marginalisation internationale. En tant que deuxième pays le plus peuplé d’Afrique, l’Éthiopie affiche une croissance démographique fulgurante. Elle fait face à des besoins pressants en énergie pour alimenter son développement industriel, électrifier les zones rurales, et soutenir une économie en transition. Le GERD, avec ses 6 450 mégawatts de capacité attendue, pourrait faire de l’Éthiopie un fournisseur régional d’électricité et renforcer son rôle géopolitique dans la Corne de l’Afrique.
La construction du GERD ravive néanmoins de vieux contentieux juridiques. L’Égypte s’appuie sur les traités de 1929 et de 1959 qui lui garantissent une part majoritaire du débit du Nil et un droit de veto sur tout projet en amont. L’Éthiopie, qui n’a jamais été partie à ces accords, rejette leur légitimité, les considérant comme un vestige de l’ère coloniale. Ce désaccord fondamental empêche la mise en place d’un cadre juridique commun pour la gestion des ressources hydriques du fleuve. Les tentatives de médiation, notamment par l’Union africaine ou les États-Unis, n’ont pas permis de trouver un terrain d’entente sur le calendrier et les modalités de remplissage du réservoir.
Le remplissage du barrage, entamé unilatéralement par l’Éthiopie en 2020, a constitué un tournant majeur. Le Caire et Khartoum ont dénoncé une atteinte au principe de coopération. En 2021, puis en 2022 et 2023, de nouvelles phases de remplissage ont été menées, ce qui a accentué la défiance. Les périodes de sécheresse constituent un point particulièrement sensible : si le niveau du Nil baisse durant plusieurs années consécutives, le remplissage du GERD pourrait limiter l’eau disponible pour les usages en aval. L’Égypte craint alors de voir ses barrages (notamment celui d’Assouan) vidés, son agriculture en péril, et des millions de citoyens touchés par une crise hydrique majeure.
Le Soudan, situé entre les deux géants, joue un rôle ambivalent. D’un côté, il redoute un impact négatif sur ses barrages et systèmes d’irrigation. De l’autre, il pourrait tirer profit d’une meilleure régulation des crues et d’un approvisionnement énergétique bon marché. Toutefois, les conflits internes qui secouent le pays ont affaibli sa capacité à peser dans les négociations. Le Soudan reste tiraillé entre ses intérêts techniques et les alliances diplomatiques variables.
L’Union africaine (UA) a tenté à plusieurs reprises de s’imposer comme médiatrice dans la crise du GERD. Sous la présidence sud-africaine en 2020, des cycles de négociation ont été lancés entre les trois pays, avec l’appui de la Commission de l’UA. Toutefois, l’organisation continentale se heurte à ses propres limites. Elle ne dispose ni de mécanismes de contrainte, ni de pouvoirs d’arbitrage juridiquement contraignants. En outre, ses membres restent divisés sur la question : certains soutiennent l’Éthiopie au nom de la souveraineté des pays sources, d’autres restent plus proches du Caire. L’UA apparaît alors comme un acteur diplomatique symbolique, mais encore trop faible institutionnellement pour influencer le cours du conflit.
Le conflit autour du Nil reflète aussi des lignes de fracture géopolitiques plus larges. La question de l’eau s’intègre dans une compétition d’influence entre puissances régionales et internationales. La Chine, principal investisseur en Afrique, a des intérêts dans les infrastructures éthiopiennes, dont certaines liées à l’énergie. La Turquie, très active en Éthiopie sur le plan économique, entretient des liens plus distants avec l’Égypte. Les Émirats arabes unis jouent un rôle discret mais croissant, tandis que la Russie, par le biais d’accords militaires et économiques, cherche à renforcer sa présence dans la région. Les États-Unis, longtemps proches de l’Égypte, ont tenté une médiation, sans succès, tandis que l’Union européenne se contente d’appels au dialogue, faute de consensus entre ses États membres. En parallèle, la récente reconnaissance de souveraineté du Somaliland par l’Éthiopie a poussé l’Égypte à se rallier à la cause somalienne pour tenter d’endiguer la prise en ampleur de l’Éthiopie.
Le contentieux autour du GERD met également en lumière l’absence d’un consensus juridique mondial sur la gestion équitable des fleuves transfrontaliers. La Convention des Nations unies de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux consacre les principes de coopération, de partage équitable et de non-préjudice significatif. Toutefois, ni l’Égypte ni l’Éthiopie n’ont ratifié cette convention. L’absence de cadre contraignant permet donc à chaque pays d’interpréter à sa manière les règles de droit, renforçant la défiance mutuelle. Ce vide juridique fragilise toute tentative de médiation fondée sur des normes universelles et donne lieu à un conflit d’interprétations diplomatiques.
Dans un contexte de changements climatiques, où les ressources en eau deviennent de plus en plus précieuses, ce différend autour du GERD illustre les futurs conflits potentiels qui pourraient émerger autour de la rareté. Le Nil, autrefois perçu comme un facteur d’unité culturelle et historique, devient progressivement une source de division et de confrontation. Certains chercheurs évoquent la possibilité « d’hydro-hégémonie », concept désignant le pouvoir d’un État à dominer les autres par le contrôle des ressources en eau. À ce jour, l’Égypte a longtemps exercé cette hégémonie, mais le GERD pourrait symboliser un basculement, une redistribution des cartes hydrauliques.
Au-delà des enjeux politiques, le GERD pourrait avoir un impact environnemental majeur sur le bassin du Nil. La retenue prolongée de l’eau derrière le barrage risque de perturber l’écosystème du fleuve, en particulier les zones humides du Soudan et du sud de l’Égypte, qui abritent une biodiversité unique. En Égypte, la salinisation des terres du delta, aggravée par la baisse du débit fluvial, pourrait entraîner une perte de surfaces agricoles fertiles. D’autre part, le changement climatique pourrait rendre les cycles hydrologiques encore plus imprévisibles, accentuant les conflits autour du remplissage du barrage lors des années sèches. Une analyse environnementale approfondie, partagée entre les trois pays, fait aujourd’hui cruellement défaut.
Les tensions autour du Nil ne sont pas seulement géostratégiques : elles ont une traduction directe sur les populations locales. En Égypte, plus de 80 % de l’eau est utilisée pour l’agriculture. Selon certaines projections, une réduction de 10 à 15 % du débit du Nil pourrait entraîner la perte de centaines de milliers d’hectares de terres cultivables et menacer les moyens de subsistance de plus de 1,5 million d’agriculteurs. L’urbanisation croissante, la pression démographique, et la pollution aggravent encore la situation. Du côté éthiopien, un ralentissement du projet pourrait empêcher des millions de foyers ruraux d’avoir accès à l’électricité, freinant les efforts de développement humain. Le Nil, source de vie, devient ainsi une ligne de fracture sociale entre pays et au sein même de leurs populations.
L’avenir du bassin du Nil dépendra largement de la capacité des États concernés à dépasser les antagonismes historiques. Il est nécessaire de mettre en place un cadre de gouvernance partagé, fondé sur la coopération, la transparence, et la solidarité hydrique. Un mécanisme multilatéral, combinant expertise technique, arbitrage indépendant et garanties de sécurité, pourrait offrir une solution durable. Cela implique également une reconnaissance mutuelle des droits au développement, à la sécurité hydrique et à la souveraineté. Mais la méfiance reste forte. La montée des nationalismes, la pression des opinions publiques, les instabilités internes et les ingérences étrangères rendent les compromis difficiles. Les prochaines années seront décisives. Soit les pays du bassin du Nil parviennent à bâtir un modèle de coopération exemplaire, susceptible d’inspirer d’autres régions confrontées aux mêmes défis ; soit les rivalités s’enkystent, faisant du fleuve une ligne de fracture aux conséquences potentiellement dramatiques.
Deux scénarios se dessinent. Le premier, conflictuel, verrait la montée en puissance d’un nationalisme hydrique, avec des postures rigides, des accusations réciproques et un durcissement diplomatique. Dans un tel contexte, les projets unilatéraux risquent de se multiplier, les populations de souffrir des ruptures d’approvisionnement, et le fleuve deviendrait un théâtre de tensions permanentes. Le second scénario, plus coopératif, supposerait la mise en place d’un accord tripartite contraignant, adossé à des mécanismes de surveillance hydrologique partagés, de gestion concertée des périodes de sécheresse, et de solidarité énergétique. Un tel accord permettrait de transformer le Nil en vecteur d’intégration régionale, à condition de dépasser les logiques de domination et d’adopter une vision de long terme fondée sur l’interdépendance.
Julien J.
Sources
- Tension diplomatique : Pourquoi l’Éthiopie s’inquiète-t-elle tant d’une alliance entre l’Égypte et la Somalie ? – BBC News Afrique. BBC News Afrique. Disponible sur : https://www.bbc.com/afrique/articles/c80e9gy9740o (Consulté le 15/05/2025).
- www.notre-planete.info (2020). �� Le colossal barrage de la Renaissance en Ethiopie, sur le Nil bleu, menace d’assécher l’Egypte. [online] Notre-planete.info. Disponible sur : https://www.notre-planete.info/actualites/4702-barrage-renaissance-Ethiopie-Egypte-Nil (Consulté le 11/05/2025).
- Emmanuelle Skyvington (2024). La bataille du Nil. [online] Télérama. Disponible sur : https://www.telerama.fr/television/la-bataille-du-nil-de-sara-creta-notre-critique_cri-7033469.p hp (Consulté le 11/05/2025).
- Fabien Feissli (2024). Le méga-barrage GERD du Nil fait craindre une guerre majeure. watson.ch/fr. Disponible sur : https://www.watson.ch/fr/international/climat/757866722-le-mega-barrage-gerd-du-nil-fait-crai ndre-une-guerre-majeure (Consulté le 11/05/2025).
- Nabila Amel (2020). Barrage éthiopien sur le Nil : la discorde entre le Soudan, l’Égypte et l’Éthiopie perdure. France Culture. Disponible sur : https://www.radiofrance.fr/franceculture/barrage-ethiopien-sur-le-nil-la-discorde-entre-le-soud an-l-egypte-et-l-ethiopie-perdure-6409128 (Consulté le 13/05/2025).
- https://www.facebook.com/bbcnews (2018). Gestion du Nil: L’Egypte et l’Ethiopie veulent éviter un conflit. – BBC News Afrique. BBC News Afrique. Disponible sur : https://www.bbc.com/afrique/region-42741455 (Consulté le 12/05/2025).
- RFI (2019). La médiation américaine acceptée dans le conflit du barrage de la Renaissance. RFI. Disponible sur : https://www.rfi.fr/fr/afrique/20191101-ethiopie-barrage-renaissance-mediation-americaine (Consulté le 11/05/2025).