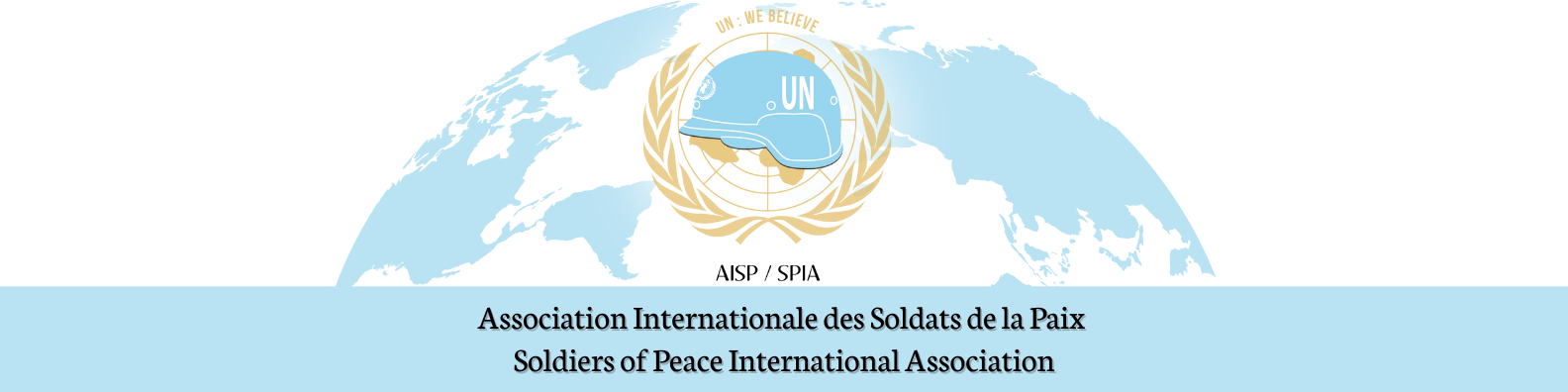Abstract :
Le Maroc est un pays émergent, en pleine expansion et qui cherche à s’inscrire de manière influente et durable sur la scène internationale. Dans un contexte où le multilatéralisme s’essouffle et où les tensions géopolitiques s’intensifient, contribuer pour la paix mondiale constitue un acte à la fois symbolique et stratégique. La contribution du Maroc dans les Opérations de Maintien de la Paix de l’ONU s’inscrit dans une démarche de solidarité, tout en répondant à des enjeux plus stratégiques, en adéquation avec les ambitions hégémoniques du pays.
Dans quelle mesure la participation du Maroc aux opérations de maintien de la paix de l’ONU sert-elle à la fois ses ambitions de solidarité internationale et ses objectifs de puissance régionale ?
Depuis sa création en 788 par les Idrissides, le Royaume du Maroc s’inscrit pleinement dans les dynamiques des relations internationales. En effet, la présence du Maroc sur la scène internationale n’est pas récente mais belle et bien historique puisqu’il est l’un des plus vieux pays au monde. Anciennement surnommé « Al Maghreb Al Aqsa », le pays du Couchant Lointain, le Maroc s’est tout de suite présenté comme un point focal religieux, politique, culturel et commercial dans la région du Maghreb. Puis, dans sa période impérialiste, le Maroc est devenu un réel carrefour incontournable en Méditerranée, au contrôle du Maghreb et d’Al-Andalus. A l’époque moderne, alors que le reste du Maghreb est sous contrôle Ottoman, le Maroc garde son indépendance et il commence à établir de solides liens diplomatiques avec la France, l’Angleterre, l’Espagne, et les Etats-Unis, dont le Maroc a d’ailleurs été le premier pays à accorder sa reconnaissance.
Depuis sa création, et tout au long de son évolution, le Maroc a continué à occuper une place significative sur la scène internationale, en s’adaptant aux contextes historiques globaux, tel que l’époque du colonialisme sous le Protectorat Franco-Espagnol, ou plus tard lors des mouvements d’indépendance quand le Maroc est devenu celui que l’on connait aujourd’hui.
Le Maroc que l’on connaît aujourd’hui est un pays émergent, qui compte une progression remarquable ces dernières années en termes de développement humain. En effet, le Royaume a dépassé le seuil des 0.700 ce qui lui permet d’intégrer la catégorie des pays à développement humain élevé, selon les critères établis par le PNUD[1]. Sur le plan international, grâce à son héritage historique, ses atouts géographiques et sa situation politique, le Maroc occupe toujours une place déterminante. Il est aujourd’hui un acteur diplomatique actif et important autant à l’échelle régionale qu’internationale. Il a su se façonner un rôle indispensable dans plusieurs questions centrales de la géopolitique mondiale, telles que la médiation entre le Monde Arabe et l’Occident, ou encore la défense et le maintien de la paix, en étroite collaboration avec les hégémonies occidentales, les puissances régionales et les organes internationaux de régulation tel que l’Organisation des Nations Unies. En effet, le Maroc représente un carrefour de plusieurs cultures et puissances aussi bien sur le plan géographique que sur le plan géopolitique, il est vu comme la « Porte de l’Afrique » mais aussi comme un pont entre les pays Africains, et dans une autre mesure les pays musulmans et de l’autre côté l’Europe et les pays occidentaux.
Cette place « au carrefour des cultures » cumulée à sa double identité Arabe et Africaine ont certes une dimension symbolique mais sont aussi très utiles pour agir concrètement sur les défis du monde contemporains, politiques, culturels, économiques et diplomatiques. Ces axes ont tout de même permis au Maroc d’ajuster sa politique extérieure autour de ces aspects de médiation, d’interculturalité et surtout de promotion de la paix dans des contextes géopolitiques souvent tendus.
Concrètement, le Maroc est devenu un des acteurs majeurs de la diplomatie globale ; engagé et actif dans la construction d’un équilibre de paix mondial, et présent sur tous les fronts en tensions, il s’efforce d’apporter sa croissante et constante contribution aux initiatives de paix lancées par les Nations Unies, notamment au Moyen-Orient et en Afrique.
- L’implication du Maroc dans les opérations de Maintien de la Paix de l’ONU.
Il y a quelques jours, le 27 septembre 2025 lors de la 80e Assemblée Générale de l’ONU à New York, le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita déclarait « Le Royaume du Maroc est un acteur agissant et proactif dans les discussions et les initiatives visant à résoudre les grandes problématiques mondiales de l’heure, à la faveur de la Vision perspicace et duleadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI »[2]
Cette déclaration met en exergue les positions bien déterminées du Maroc sur la scène internationale, et son rôle dans les dynamiques de sécurité collective impulsées par l’ONU.
Le Maroc n’est pas une simple puissance émergente, il prétend à bien plus, le pays de l’Atlas cherche à se positionner de manière influente sur la scène géopolitique et diplomatique mondiale. Cette implication pour la paix n’est pas toute récente, elle représente tout un pan de l’histoire de politique extérieure du pays.
En 2023, le Maroc était déjà le 11e pays contributeur aux opérations de maintien de la paix à l’ONU.[3]
En effet, dès 1960, soit à peine 4 ans après son indépendance des protectorats, le Maroc initie son implication dans les opérations de maintien de la paix avec l’ONUC (Opération des Nations Unies au Congo). Afin de manifester son idéologie pacifiste et sa solidarité africaine, le pays envoie un contingent militaire dans le but de soutenir la stabilisation sécuritaire et politique au Congo. L’envoie de ces quelques milliers de soldats marocains au Congo marque le début d’une volonté pérenne d’agir pour la paix.
Depuis ses débuts dans les Opérations de Maintien de la Paix, l’implication du Maroc s’est majoritairement orientée vers les zones qui lui sont culturellement familières à savoir l’Afrique et le Moyen-Orient.
La majeure partie de l’implication marocaine dans les opérations de maintien de la paix se concentre sur le territoire africain. Après s’être investi au Congo, le Maroc a envoyé des effectifs en Angola (1989, UNAVEM I). De manière plus conséquente, c’est en Somalie dans le cadre des opérations ONUSOM I et ONUSOM II[4] que les Forces armées royales ont ensuite été envoyées entre 1992 et 1994[5]. La même année, les forces armées royales étaient déployées en Côte d’Ivoire (1994, ONUCI). En 2019, le Maroc intervenait encore dans le sous-continent, en République Centrafricaine dans le contexte de l’opération MINUSCA.
Les efforts fournis par le Maroc sur le continent africain témoignent d’une conscience d’appartenance profonde à l’identité africaine animée aussi par le sentiment de solidarité liant le Royaume à ses voisins du Sud.
Par ailleurs, le Maroc, comme nous le savons est doté d’une double culture à la fois arabe et africaine. C’est un pays arabe et musulman, et il accorde une place prépondérante à la défense de la paix dans les pays musulmans et arabes pour lesquels il s’est érigé en tant que médiateur régional.
Le pays est donc devenu le médiateur régional, promouvant le dialogue et l’instauration de moyens pacifiques pour la résolution de conflits. Il s’est investi dans aussi militairement dans les zones de conflits à travers l’envoie de troupes ou d’effectif non militaire dans le cadre des opérations de maintien de la paix de l’ONU.
En 1974, le pays envoie ses forces royales au FNUOD en opération sur le plateau du Golan. Pus tard, en 1978, le pays rejoint la FINUL au Liban. Et se retrouvera aussi à la frontière entre le Koweit et l’Irak [1]en 1991 après la guerre du Golfe afin de garantir le cessez-le-feu.
Le pays n’a pas uniquement contribué à ces opérations de maintien de la paix par le simple envoie de troupes militaires mais son implication est en fait diversifiée, afin de toujours refléter l’ambition ambivalente du Maroc à la fois sécuritaire et humanitaire. Même si, depuis 1960, près de 70 000 militaires et policiers ont été déployés[6]. Le Maroc a aussi envoyé dans chacun des fronts, des experts et des observateurs afin de conseiller et surveiller les opérations en cours. Enfin, le Maroc s’est également investi pleinement dans le domaine humanitaire en envoyant des équipes médicales et humanitaires et en mettant en place des hôpitaux de campagne sur place aux fronts comme notamment l’hôpital de campagne à Beyrouth au Liban suite à l’explosion au port qui a paralysé tout le pays [7].
Ces contributions multiples sont à l’image d’un désir clair de la part du Maroc de s’inscrire dans les dynamiques mondiales de « préservation de la paix, l’encouragement de la stabilité et le respect de l’intégrité territoriale des États »[8] tout en respectant les grandes positions et orientations de sa politique extérieure à savoir la solidarité africaine, l’appartenance aux pays arabes et la coopération Sud-Sud[9]. Nous l’avons compris, le Royaume du Maroc, depuis sa création, cherche à s’impliquer dans les dynamiques mondiales, et d’échanges internationaux. Pour chaque époque, une différente manière de s’inclure, une différente ampleur et un rôle différent. Un seul aspect ne change pas, c’est bien les enjeux derrière cette implication constante.
- Les enjeux de cette implication.
En effet, à travers cette publication, le but est d’appréhender non pas la manière dont le Maroc est devenu un acteur central sur la scène internationale mais plutôt de comprendre les attentes escomptées derrière ces efforts déployés. Le Roi Mohammed VI, ainsi que son père Hassan II, a donc bien compris que pour gagner en influence et en poids dans un monde multipolaire et face à des hyperpuissances, il fallait diversifier les moyens engagés. Ici, la puissance douce (« soft power ») et d’influence, constitue un moyen pertinent d’atteindre les objectifs hégémoniques du pays. Il est effectivement plus délicat de distinguer la limite entre « hard power » et « soft power » dans le cadre de la question de participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU. L’action militaire en elle-même relève évidemment du champ du « pouvoir de contrainte » [10] puisqu’à travers l’envoie de troupe, le Maroc emploie le recours à la force. Néanmoins, il convient d’admettre que ce sont les motivations qui prévalent lors de l’analyse de cette question. Pourquoi le Maroc investit-il des troupes dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU ? C’est avant tout dans un souci humanitaire et de solidarité, pour venir en aide aux pays, peuples et zones en difficulté.
En réalité, l’aide humanitaire inscrite dans une dynamique de « soft power »[11], va bien au-delà du devoir de solidarité. Ici, il est question d’un soft power qui se définit comme « la capacité d’un État à influencer et à orienter les relations internationales en sa faveur. L’État met en œuvre une stratégie d’influence. » Dans le cas du Maroc, cette stratégie d’influence se base sur sa participation aux opérations de maintien de la paix. Pour aller plus loin, cette diplomatie douce, « renforce ainsi la légitimité de son action internationale, ce qui constitue également un facteur de puissance. Cette influence s’exerce autant à l’égard des adversaires que des alliés et vise tous les acteurs des relations internationales ».
Cette définition du « soft power », nous permet donc d’intercepter pleinement les réels enjeux derrière l’implication du Maroc dans les OMP de l’ONU.
Au-delà du simple désir de venir en aide à la communauté internationale, le Maroc, à l’image de plusieurs autres pays émergents impliqués dans les opérations de maintien de la paix, est motivé par des intérêts plus particuliers.
Premièrement, nous l’avons vu, grâce à ces participations, le Maroc est devenu plus influent, avec l’image d’un pays puissant, et impliqué sur la scène internationale. Ensuite, et de manière plus stratégique, la participation du Maroc aux missions des Nations unies place le pays en position de force pour mener des négociations diplomatiques en vue de préserver ses intérêts. Par exemple, en mars 2019, le Royaume réaffirmait avec fermeté son leadership sur le Sahara occidental lors de la Conférence ministérielle de Marrakech. Rabat a pu imposer ses vues en rappelant « l’exclusivité des Nations unies en tant que cadre de recherche d’une solution politique, mutuellement acceptable, réaliste, pragmatique et durable à la question du Sahara ».
Enfin, d’un point de vue plus concret et pratique, cet investissement sert également à professionnaliser la troupe et moderniser la défense. Le professionnalisme des FAR s’est affirmé avec la fréquence élevée des missions de paix comme l’attestent les données présentées dans le tableau mentionné précédemment. Ces opérations sous l’égide des organisations internationales (ONU, OTAN) ont permis d’améliorer le comportement des soldats, de sensibiliser la troupe au genre dans les OP et de développer une bonne conduite des soldats qui affichent un comportement discipliné.
La participation aux opérations lancées par l’ONU, sont pour le Maroc et d’autres pays émergents, bien plus qu’un simple élan de solidarité. Les enjeux derrière ces engagements profitent à la fois au pays acteur et à la communauté internationale qui reçoit son aide. Dans un monde globalisé et multilatéral, où les pays sont tous interdépendants les uns des autres, chaque initiative sur la scène internationale renferme des enjeux plus stratégiques. Les pays émergents, souvent relayés au second rang sur la scène internationale, cherchent des alternatives pour gagner en influence et en poids face aux hégémonies. Les organisations internationales, qu’elles soient de régulation ou de coopération représentent de bons biais pour ces petites puissances qui tentent de jouer un rôle impactant à l’international. Ainsi, les opérations de maintien de la paix de l’ONU à travers leur dimension internationale et humanitaire, permettent à ces pays de pouvoir allier l’utile à l’agréable. Ils s’engagent auprès de l’ONU pour venir en aide aux pays et peuples en crises, et cela leur permet d’une certaine manière d’également venir en aide à leur propre pays sous certains aspects. En définitive, l’engagement du Maroc dans les opérations de maintien de la paix illustre la double vocation du Royaume : celle d’un acteur solidaire fidèle à ses valeurs africaines et arabes, mais aussi celle d’une puissance émergente cherchant à consolider son influence dans un ordre international en mutation.
A l’avenir, cette diplomatie d’équilibre pourrait renforcer la position du Maroc comme pivot entre les puissances du Nord et du Sud.
[1] « Le Maroc franchit un cap en développement humain selon le Rapport mondial en 2025 du PNUD. » 7 mai 2025. https://www.undp.org/fr/morocco/communiques/le-maroc-franchit-un-cap-en-developpement-humain-selon-le-rapport-mondial-2025-du-pnu
[2] Allocution du Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita à la 80e Assemblée Générale de l’ONU.
[3] « Le Maroc classé 11e pays contributeur aux opérations de maintien de la paix de l’ONU ». Maroc Diplomatique. https://maroc-diplomatique.net/le-maroc-classe-11eme-contributeur-aux-operations-de-maintien-de-la-paix-de-lonu
[4] J-M. Sorel. (1992). La Somalie et les Nations-Unies. Annuaire français de droit international. https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1992_num_38_1_3064
[5] Wikipédia. Opération des Nations Unies en Somalie. https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_des_Nations_unies_en_Somalie_I [Consulté le 30/09/2025]
[6] S. El Ouardighi. (2020). « Récit de la participation du Maroc à la guerre de 1973 raconté par un officier des FAR » https://medias24.com/2020/10/14/recit-la-participation-marocaine-a-la-guerre-de-1973-racontee-par-un-officier-des-far/
[7] « Morocco is the 11th largest contributor to Blue Helmets peacekeeping » Hespress. https://en.hespress.com/64751-morocco-is-the-11th-largest-contributor-to-blue-helmets-peacekeeping.html?utm_source
[8] « Hôpital militaire marocain de campagne à Beyrouth : une unité hospitalière salvatrice ». L’Observateur du Maroc et d’Afrique. https://www.youtube.com/watch?v=JMHPiBfW9HM
[9] « Le Maroc acteur majeur de la paix et de la stabilité dans le monde depuis plus de 60 ans ». Le Matin. https://lematin.ma/journal/2016/le-maroc-acteur-majeur-de-la-paix-et-de-la-stabilite-dans-le-monde-depuis-plus-de-60-ans/248517.html
[10] B. Badie. Quand le Sud réinvente le monde. Essai sur la puissance de la faiblesse. 2018.
[1] Joseph S. Nye Jr, Soft Power, The Means To Success In World Politics, New York, Public Affairs, 2004, 191 p.
[11] « Qu’est-ce que le soft power ? ». Vie Publique. https://www.vie-publique.fr/fiches/38155-quest-ce-que-le-soft-power [Consulté le 3 octobre 2025].
Asma Khziba – Hilali