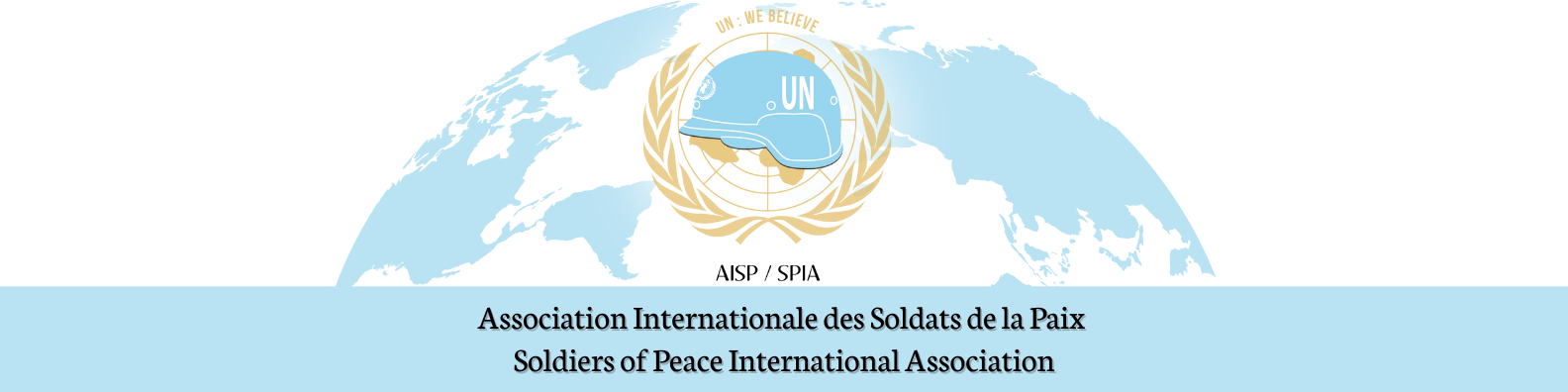Depuis le dimanche 4 mai 2025, les Libanais sont appelés aux urnes pour élire leurs conseils municipaux. Cet événement électoral est d’une portée symbolique et politique majeure : il s’agit des premières élections municipales organisées depuis 2016, dans un contexte national lourdement marqué par une crise économique, une instabilité politique chronique et une situation sécuritaire volatile. Ces élections, initialement prévues en 2022, avaient été reportées à trois reprises en raison du manque de financement public, de l’effondrement des institutions, mais aussi en raison du conflit armé entre Israël et le Hezbollah, qui a particulièrement secoué le sud du Liban entre 2023 et 2024.
Le retour des municipales a donc été perçu comme un pas vers une relative normalisation de la vie politique locale. Il s’agit d’un test de la résilience démocratique d’un pays dont les institutions ont été largement paralysées depuis la révolte populaire d’octobre 2019, puis par la démission successive de plusieurs gouvernements et la vacance présidentielle depuis 2022. Pour nombre de Libanais, ces élections représentent un moment d’espoir et de réappropriation citoyenne, dans un contexte où la confiance envers la classe politique est au plus bas.
Une organisation inédite en quatre étapes :
4 mai : Mont-Liban, incluant le Kesrouan-Jbeil ;
11 mai : Liban-Nord et Akkar ;
18 mai : Beyrouth, Békaa et Baalbek-Hermel ;
24 mai (samedi exceptionnellement) : Liban-Sud et Nabatiyé
Le choix du samedi 24 mai pour les élections dans le sud s’explique par la commémoration nationale du 25 mai, jour de la libération du sud du Liban en 2000, date symbolique célébrant le retrait de l’armée israélienne après 18 ans d’occupation. Une date particulièrement sensible dans des régions fortement marquées par l’empreinte du Hezbollah et les tensions récurrentes avec l’État hébreu.
Le mode de scrutin demeure inchangé : les électeurs votent dans leur localité d’origine ce qui, dans un pays à forte mobilité interne et à large diaspora, complexifie le processus. Dans certaines communes, la majorité des électeurs inscrits ne réside plus sur place. Chaque électeur élit les membres du conseil municipal de sa commune d’origine, qui désignent ensuite, parmi eux, un président (équivalent du maire). Ces conseils seront à la tête de diverses missions parmi lesquelles on retrouve : l’urbanisme, la propreté, la voirie, la santé publique locale, la gestion des déchets, la sécurité, ou encore la régulation des commerces. À une époque où l’État central est quasi absent, la gestion municipale est souvent le seul levier concret de gouvernance visible pour les citoyens.
Malgré l’importance de ces élections, de nombreuses communes ont vu leurs conseils élus par acclamation, faute de listes concurrentes. Ce phénomène, plus répandu dans les régions rurales ou sous influence politique forte, souligne le déficit de pluralisme et la réticence de nombreux citoyens à s’engager dans des processus perçus comme verrouillés à l’avance.
Un scrutin sous influence :
Le système électoral libanais autorise le panachage : les listes proposées ne sont pas bloquées. Les électeurs peuvent librement supprimer, modifier ou ajouter des noms. Cette souplesse, théoriquement démocratique, ouvre en pratique la voie à toutes sortes de manipulations locales, de clientélisme et de pressions communautaires. Dans de nombreuses localités, la réalité du vote se fait sous l’influence directe de forces politiques ou communautaires. Des partis tels que le Hezbollah, les Forces Libanaises, le Courant du Futur (en déclin), le Mouvement Amal ou encore le Courant Patriotique Libre (CPL) s’appuient sur des relais communautaires puissants pour assurer leurs résultats, parfois au mépris du pluralisme. Ainsi, le scrutin se joue souvent bien avant l’ouverture des urnes.
Le sud du pays : un vote compromis ?
Les enjeux sont encore plus complexes dans le Sud, région fortement touchée par les récentes confrontations militaires avec Israël. Certaines localités sont aujourd’hui totalement inaccessibles : soit parce que l’armée israélienne occupe toujours des zones frontalières contestées, soit parce que les bombardements israéliens se poursuivent de manière sporadique malgré le cessez-le-feu officiellement instauré.
Dans d’autres villages, les dégâts sont tels que les infrastructures électorales (bureaux de vote, écoles, routes) sont inutilisables. Cela pose un grave problème pour la représentativité du vote prévu le 24 mai. De nombreuses ONG locales dénoncent déjà une élection partielle, voire fictive, dans certaines municipalités sinistrées. Ces conditions exceptionnelles soulèvent la question de l’équité du processus électoral et pourraient entacher la légitimité des conseils élus dans les zones concernées.
À Beyrouth, la situation est plus complexe encore. La capitale libanaise, historiquement marquée par un équilibre confessionnel fragile entre chrétiens et musulmans, est désormais à la croisée des chemins. Depuis 1998, grâce à l’intervention de la FINUL, la capitale avait réussi à préserver une forme de parité entre les deux grandes communautés religieuses. Mais cette stabilité est aujourd’hui remise en cause par l’effondrement de plusieurs partis politiques traditionnels. Le retrait du mouvement de Sarath Khalili, acteur central du paysage politique beyrouthin, pourrait profondément modifier l’issue du vote. Ce vide crée une ouverture inédite pour de nouveaux venus et renforce la compétition, tout en accentuant les risques de fragmentation. Conscients des dérives liées à l’absence de listes fermées, plusieurs députés ont proposé de faire voter une exception pour Beyrouth afin de garantir un cadre électoral plus strict. À l’heure actuelle, cette initiative n’a pas encore été adoptée, mais elle illustre bien la tension autour du scrutin dans la capitale.
Une recomposition politique en cours
Les élections municipales de 2025 servent aussi de baromètre pour la scène politique nationale. Elles permettent d’évaluer la popularité des partis dans un contexte post-crise. Le Courant Patriotique Libre (CPL), autrefois l’un des piliers du pouvoir, apparaît comme le grand perdant de ces municipales. Depuis son éloignement progressif du Hezbollah et son passage dans l’opposition, le parti de Gebran Bassil semble en perte de vitesse. Les résultats déjà disponibles dans le Mont-Liban le confirment, avec un recul notable dans plusieurs fiefs historiques.
À l’inverse, certains mouvements civils ou indépendants issus de la société civile (notamment ceux apparus lors de la révolution d’octobre 2019) tentent de percer, avec des succès variables selon les régions. Leur émergence reste toutefois entravée par des obstacles structurels : manque de financement, faiblesse des réseaux locaux, et parfois intimidation. Dans les premières régions à avoir voté (Mont-Liban, Liban-Nord, Akkar), le taux de participation se situait aux alentours de 43 à 45 %. Un chiffre modeste mais honorable dans un pays frappé par la défiance envers la politique, les difficultés de transport, et la démobilisation de la jeunesse. Le ministère de l’Intérieur a recensé plusieurs incidents, notamment des échanges de tirs festifs et des violences ponctuelles. Dans l’ensemble, cependant, le processus s’est déroulé sans heurts majeurs.
Les élections municipales de mai 2025, bien que locales dans leur portée, s’inscrivent dans un processus plus vaste de redéfinition du paysage politique libanais. Elles témoignent à la fois de la volonté d’une partie de la population de reprendre en main son destin politique, et des résistances persistantes d’un système verrouillé et miné par les ingérences régionales.
À l’aube de l’échéance présidentielle (toujours incertaine), ces élections auront valeur de test. Un test de crédibilité démocratique pour un pays qui peine à se reconstruire, mais aussi un test de maturité citoyenne pour une population en quête d’alternatives. Le Liban joue peut-être là une partie de son avenir. Mais au-delà des chiffres, des alliances et des stratégies, il reste surtout l’espoir. L’espoir qu’un jour, les générations futures puissent voter librement, vivre dignement, et bâtir un pays à la hauteur de son surnom d’antan : la Suisse de l’Orient. Un Liban stable, prospère et exemplaire, capable de renaître de ses cendres et d’incarner à nouveau un modèle de coexistence et de culture.
Matys Kocaj-Grienenberger