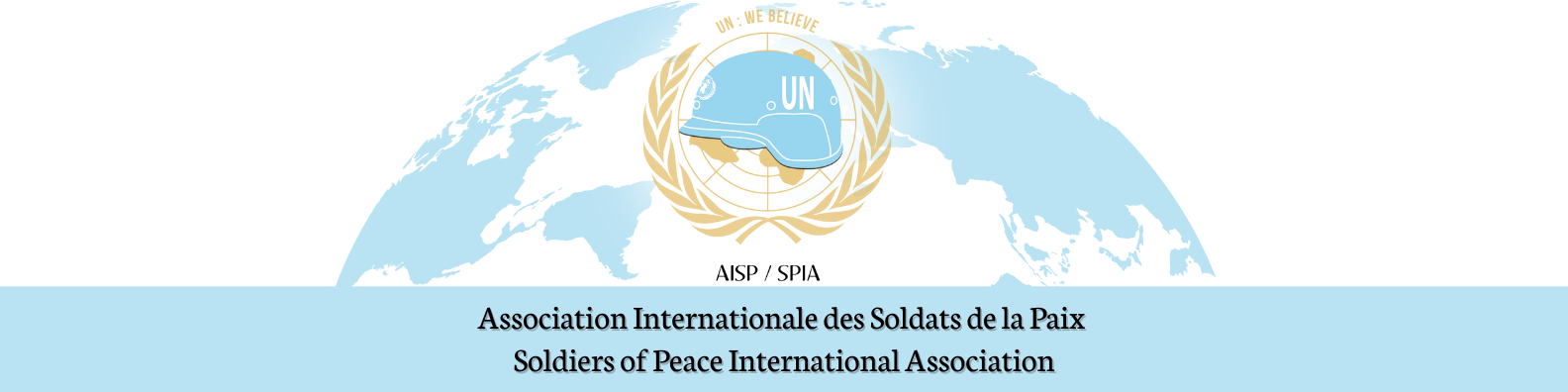La diplomatie internationale ne se limite pas aux accords économiques ou politiques : la langue elle-même est un instrument de pouvoir et de négocation. Cet article examine comment des erreurs linguistiques, des imprécisions de traduction ou des interprétations culturelles ont influencé l’histoire diplomatique. Nous analyserons les conséquences profondes d’un mot mal compris à travers des études de cas célèbres : du terme japonais mokusatsu à la déclaration de Khrouchtchev, en passant par le traité de Waitangi et les résolutions de l’ONU. En outre, nous analyserons comment l’ambiguïté linguistique peut influencer la perception des messages et des politiques internationales.
” Les limites de ma langue signifient les limites de mon monde “ (Wittgenstein Project, s.d.)
Cette phrase de Ludwig Wittgenstein, nous rappelle que la manière dont nous parlons et comprenons le langage limite ou élargit notre capacité à comprendre le monde. Dans le cas de diplomates, elle peut déterminer le succès ou l’échec d’une négociation. Dans un monde globalisé, la langue constitue un pilier fondamental dans les relations internationales. Même la plus petite nuance linguistique peut conditionner la réception d’un message et les décisions politiques qui en découlent.
En effet, la communication est déjà très compliquée dans la vie quotidienne : on ressent certaines tensions entre collègues, amis ou membres de la famille, même lorsqu’ on parle la même langue. Cet obstacle apparaît encore plus difficile dans les relations internationales, où chaque nation se distingue par ses lois, ses références culturelles, sa culture et sa langue. Il y a une multitude de points de vue comme par exemple un diplomate peut percevoir un mot comme une menace, un citoyen étranger comme un message neutre ou un journaliste comme une critique, tout cela à partir des mêmes paroles. Donc la traduction et l’interprétation sont essentielles : lorsque les mots sont mal compris ou mal traduits, les conséquences peuvent être graves, voire changer l’histoire.
LES ERREURS DE TRADUCTION INVOLONTAIRES
Le cas “Mokusatsu” (1945)
En juillet 1945, l’un des exemples les plus célèbres d’erreur de traduction dans l’histoire des relations internationales fut avec le mot japonais “mokusatsu”. (National Security Agency. Mokusatsu s.d.). À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les pays alliés se sont réunis à Potsdam et ont présenté au Japon les termes d’une déclaration de reddition.
Les termes ont été traduits de l’anglais en japonais et les Alliés attendaient avec impatience la réponse du Premier ministre, Kantaro Suzuki. Le communiqué de Potsdam a été un ultimatum qui exigeait la reddition immédiate du Japon. Il a été souligné que “toute réponse négative du Japon entraînerait une destruction rapide et absolue”. Aucune décision n’avait été prise et Suzuki a répondu qu’il “évaluait la situation”. Le premier ministre japonais a déclaré qu’il “s’abstient de commenter pour le moment” (National Security Agency, s.d.).
Le premier a utilisé le mot-clé Mokusatsu pour exprimer ses pensées.
Ce mot peut avoir différentes significations selon le contexte : garder le silence à propos de, réfléchir avant de répondre, ou encore ignorer. Les agences médiatiques et les traducteurs ont choisi la définition “traiter avec mépris silencieux” (“ignorer délibérément avec mépris”,). Pourtant la traduction publiée par les médias occidentaux était : “le gouvernement japonais ignore la déclaration de Potsdam”. (Aslayan 2021)
Les dirigeants américains avaient compris que le Japon refusait catégoriquement toute négociation. Interprétée comme un rejet méprisant de l’ultimatum allié, cette réponse a contribué à renforcer la décision du président Truman d’utiliser l’arme atomique contre Hiroshima le 6 août, puis contre Nagasaki le 9 août 1945. (Kawai 1953).
Après la guerre, beaucoup de linguistes et diplomates ont analysé cet incident. Une partie a souligné que c’est un terme ambigu, qui est souvent utilisé par les responsables japonais pour éviter une réponse immédiate ou gagner du temps. Une autre partie a constaté qu’il s’agissait d’une erreur de traduction tragique, qui s’est provoquée à cause de méconnaissance du contexte politique et culturel japonais. (Pangeanic 2023). Cet épisode a vraiment aggravé la tension diplomatique et influencé une des décisions militaires les plus lourdes du XXe siècle. Cet exemple rappelle l’importance d’agir avec précision linguistique dans la diplomatie : il faut comprendre toutes les nuances culturelles et politiques, puisqu’ il peut signifier la différence entre la paix et la guerre.
Le cas de Khrouchtchev : “ We will bury you ” (1956)
En novembre 1956, en pleine Guerre froide, Nikita Khrouchtchev, Premier secrétaire du Parti communiste de l’Union sovietique, avait fait une déclaration célèbre lors d’une réunion à l’ambassade de Pologne à Moscou pour le départ du leader polonais Władysław Gomułka. Khrouchtchev était célèbre pour ses paroles excentriques et son comportement très sincère qui ne correspondait pas au langage diplomatique et le peuple en était étonné. (Alexandra 2022)
Khrouchtchev a toujours parlé ouvertement des ambitions soviétiques de rivaliser avec l’Ouest. Il n’a jamais été prudent dans le choix des expressions, l’une d’entre elles était : ”Мы вас похороним“ (translittéré “My vas pokhoronim”). Cette expression idiomatique peut se traduire littéralement par “Nous vous enterrons”, en anglais “We will bury you”. (Idiomatic 2025) Cette déclaration a eu beaucoup de répercussions dans les capitales occidentales : elle a été interprétée comme une menace nucléaire directe de l’URSS envers l’Ouest, en augmentant la possibilité d’une course aux armements et d’un conflit inévitable entre les deux blocs. (DelicaText 2024).
Pendant la guerre froide, quand un dirigeant puissant dit « Nous vous enterrerons », on ne peut pas l’ignorer. Khrouchtchev a été provocateur en disant ça devant un groupe d’étrangers. Le Time Magazine a écrit que Khrouchtchev avait fait « un discours intempérant qui trahissait autant qu’il menaçait ». Pendant son discours, plusieurs diplomates ont quitté la salle. (Time Magazine Archives 1956).
Le grand malentendu a amené le public à penser que les Soviétiques tueraient et enterreront tous les Américains, ce qui n’était pas ce que Khrouchtchev voulait dire.
En 1959, Khrouchtchev a expliqué qu’il n’avait pas l’intention de creuser une vraie tombe avec une pelle. « Ce que j’avais en tête étaient les perspectives de développement de la société humaine. Le socialisme succédera inévitablement au capitalisme », a-t-il déclaré. (Wikipedia 1959). Il voulait dire que le capitalisme était voué à l’effondrement et que les bolcheviks et le communisme allaient survivre.
Il y a eu de nombreuses conséquences diplomatiques : cette phrase a accru la méfiance entre l’URSS et les États-Unis et a renforcé le discours américain sur la nécessité de maintenir une supériorité militaire et nucléaire pour contrer l’URSS. Cet incident a fait comprendre la difficulté d’établir une coexistence pacifique entre deux systèmes d’idéologie différente. Enfin, sur le plan linguistique et diplomatique, on a pu constater qu’un simple mot mal interprété pouvait créer une immense tension. Les traducteurs et interprètes deviennent de véritables acteurs diplomatiques (Matteucci 2001).
Le traité de Waitangi
Le traité de Waitangi, signé en 1840 entre la Couronne britannique et plusieurs chefs maoris de Nouvelle-Zélande, est l’un des exemples les plus dramatiques et emblématiques de la façon dont une erreur de traduction peut altérer le cours de l’histoire. (Waitangi Tribunal s.d.) Officiellement, le traité avait pour but d’établir un accord pacifique entre les colonisateurs européens et les peuples indigènes, garantissant la protection et la reconnaissance mutuelle. Cependant, les versions en anglais et en maori ne correspondaient pas. (Dawson s.d).
Dans le texte anglais, le traité affirmait que les chefs maoris cédaient leur « sovereignty » (souveraineté) à la reine d’Angleterre.
De cette façon, les territoires, les institutions locales et les lois passaient sous le contrôle total de la Couronne du point de vue britannique. En effet, la souveraineté implique un pouvoir suprême et indivisible. Par contre, dans la version en langue maori, le terme « kawanatanga » a été utilisé pour traduire « sovereignty », qui dérive du néologisme kawana (gouverneur), introduit par les missionnaires pour désigner la figure du « gouverneur » colonial. (Matteucci 2001)
Quoi qu’il en soit, « kawanatanga » a une signification différente de celle du concept occidental de souveraineté. Dans la culture et le langage maori de l’époque, cela signifiait une administration ou une gestion politique limitée, comme une « gouvernance » partagée. (Fiveable, s.d)
Par la suite, les chefs maoris ont interprété le traité comme un accord de protection et d’alliance, dans lequel les Britanniques seraient chargés des affaires extérieures ou des relations avec les Européens, tandis que les chefs maoris conserveraient leur autorité traditionnelle (rangatiratanga) sur leurs communautés et territoires. (NZ History s.d). Au contraire, ce document représentait la cession définitive de la souveraineté et l’annexion légitime de la Nouvelle-Zélande à l’Empire britannique.
Au cours des décennies suivantes, le gouvernement colonial britannique et, plus tard, le gouvernement néo-zélandais, ayant consacré la pleine souveraineté par le traité, confisquèrent de vastes portions de terres maories en prétendant que le traité avait consacré leur pleine souveraineté. Cela a eu des conséquences dévastatrices, car les Maoris se sont sentis trahis parce qu’ils pensaient que leurs droits étaient garantis par le traité. (Taonga 2019)
Ensuite, il y a eu des révoltes armées, une longue série de batailles juridiques et des guerres territoriales qui ont duré plus d’un siècle.
Le gouvernement a créé le Waitangi Tribunal, un organe permanent qui examine les revendications maories relatives aux violations du traité et propose des compensations économiques symboliques. De plus, le traité de Waitangi reste un thème central dans la vie politique et sociale néo-zélandaise. (Waitangi Tribunal s.d)
Cette divergence sémantique, née d’une traduction imparfaite mais aussi d’une grande différence culturelle et conceptuelle, montre la responsabilité politique, historique et éthique du traducteur. On peut comprendre comment chaque choix lexical peut renverser l’interprétation d’un droit ou même la perte d’une autonomie. (Erudit.org 2018). Dans le domaine diplomatique, la précision est donc une question de justice et de pouvoir, comme le montre le traité de Waitangi une erreur de traduction peut se transformer en une erreur de souveraineté. (Meredith et Higgins 2015)
Zhou Enlai et la phrase « Trop tôt pour juger » : le mythe né d’une erreur de traduction
En 1972, Zhou Enlai, le premier ministre de la République populaire de Chine, aurait déclaré qu’il était « trop tôt pour juger la Révolution française ». En diplomatie, peu de phrases ont eu autant de résonance symbolique que celle-ci. Pendant des décennies, cette blague a été interprétée comme une sagesse typique de la pensée politique chinoise. Mais il s’agissait en réalité d’un malentendu linguistique qui démontre à quel point la communication diplomatique est fragile.
Cet épisode s’est produit en février 1972, lors de la visite organisée par Henry Kissinger, le conseiller à la sécurité nationale du président américain Richard Nixon en Chine. Les deux pays cherchaient un rapprochement stratégique pendant la guerre froide, c’était donc un moment décisif et l’objectif commun était de contenir l’Union soviétique.
Zhou Enlai, diplomate et révolutionnaire lors d’un dîner officiel, a eu une conversation avec Kissinger sur les révolutions et l’histoire occidentale et quand l’interlocuteur a fait référence à la « Révolution française », Zhou a répondu : « It’s too early to say. » (il est trop tôt pour le dire).(Myth Alert 2011). Cette phrase a été interprétée par les américains présents et la presse occidentale comme une réflexion sur la Révolution de 1789, survenue environ deux siècles auparavant.
Par conséquent, la citation semblait incarner la capacité de raisonner sur des temps historiques nettement plus longs que l’Occident à travers une vision millénaire et philosophique de la Chine, parce que la pensée qu’un dirigeant chinois pourrait considérer comme « prématurée » Tirer des conclusions sur un événement aussi lointain semblait vraiment extraordinaire.
Pendant de nombreuses années, Zhou a été cité par des journalistes, des politiciens et des universitaires comme un symbole de la capacité de la Chine à observer l’histoire à travers une attitude prudente et réfléchie. Dans les livres et articles, la citation de Zhou Enlai a pris une valeur métaphorique : la Chine n’agit pas rapidement, elle attend le cours de l’histoire. (Quote Investigator 2025). Elle a également été citée dans des textes de philosophie politique, de stratégie économique et de relations internationales.
En fait, en 2011, un diplomate américain qui était au dîner a avoué qu’il s’agissait d’un malentendu linguistique. En effet, selon Charles W. (Chas) Freeman Jr., jeune interprète et collaborateur de Kissinger, Zhou ne se référait pas du tout à la Révolution française de 1789, mais aux « événements de 1968 » c’est-à-dire les manifestations étudiantes et sociales qui avaient eu lieu en France quatre ans auparavant. (Myth Alert 2011).
Il est donc très probable que, dans la conversation, Kissinger ait cité « la révolution en France », voulant dire 1968 mais que les Américains aient compris et traduit comme la Révolution française. Par la suite, dans de nombreux entretiens, Freeman a confirmé que la réponse de Zhou était logique dans ce contexte. Car en 1972, il était « trop tôt » pour analyser les conséquences du mai français. Le méfait dérive donc de la superposition sémantique entre révolution et événements, ces deux termes en français peuvent avoir un sens très différent, mais les anglophones perçoivent comme équivalent.
Dans ce cas, une erreur de traduction a transformé une simple observation en une maxime philosophique universelle (Quote Investigator 2025). Peut-être que l’Occident avait inconsciemment besoin de cette représentation, en pleine guerre froide, la Chine était en fait perçue comme un mystère et cette citation qui avait fait de Zhou Enlai un symbole de la patience orientale, capable de porter un jugement sur les événements humains à l’échelle séculaire, il fournissait une clé poétique pour la comprendre.
La traduction en diplomatie n’est jamais un simple transfert linguistique, l’interprète dans ce contexte politique et international doit aussi être médiateur historique et culturel. Traduire, dans ces contextes, signifie « décider de ce qui restera dans l’histoire ». (Chaix 2025).
Ces quatre exemples : Mokusatsu (1945), We will bury you (1972), le traité de Waitangi (1840) et It’s too early to say” (1972), montrent comment dans la diplomatie chaque mot peut devenir une arme ou un malentendu. Dans un monde globalisé, où les rencontres entre différentes cultures sont quotidiennes, apprendre à comprendre les subtilités culturelles, l’histoire, les sensibilités n’est pas seulement une question linguistique, mais une condition nécessaire pour la paix et la coopération internationale.
Si les erreurs de traduction peuvent provoquer des malentendus, des crises involontaires et même changer le cours de l’histoire, certaines ambiguïtés linguistiques ne sont pas accidentelles. La langue devient ainsi un véritable instrument diplomatique, à travers des stratégies de persuasion et de négociation.
Les diplomates apprennent l’art de l’ambiguïté, en utilisant des mots neutres, des expressions qui peuvent être comprises de plusieurs façons et des formules ouvertes selon la sensibilité culturelle de l’interlocuteur. En effet, dire trop explicitement ce que l’on pense peut lier le gouvernement à sa position qui ne peut pas revenir en arrière sans perdre de crédibilité ou d’autorité. Donc, garder des phrases vagues ou ambiguës ouvre la possibilité d’interprétations différentes et de solutions futures. (Afkir s.d.)(Haine 1995)
Il est bon de garder à l’esprit que cette stratégie linguistique n’est pas le signe d’un manque de clarté ou de faiblesse, mais c’est une technique développée par l’expérience et la conscience du fait que les mots ont un pouvoir énorme. On utilise donc des phrases comme « la situation est en cours d’évaluation » ou « les discussions se poursuivent dans un esprit constructif », qui permettent de gagner du temps et de ne pas alimenter des tensions.
L’AMBIGUITE ET LA STRATÉGIE LINGUISTIQUE DANS LA DIPLOMATIE
Le concept d' »ambiguïté constructive » (constructive ambiguity) est devenu célèbre grâce à Henry Kissinger, alors secrétaire d’État des États-Unis dans les années 1970. Un exemple emblématique d’accord international rédigé de manière volontairement vague sont les Accords de Camp David de 1978, signés entre l’Egypte et Israël sous la médiation du président Jimmy Carter.
En effet, des termes tels que « retrait des territoires occupés » ou « reconnaissance mutuelle » ont été délibérément formulés de manière ambiguë. Le sens pouvait varier selon la perception des deux parties : pour l’Egypte et le monde arabe, « retrait » représentait une promesse de restitution complète, pour Israël, en revanche, cela ne signifiait pas nécessairement l’abandon total des territoires.
Malgré tout, ce flou linguistique a permis de conclure un accord de paix qui a mis fin à des décennies de conflit ouvert. (U.S Department of State 1978).
Dans tous les cas, cette technique peut être vraiment dangereuse, car un texte ambigu peut générer des conflits et des malentendus futurs. Les mots prononcés dans le passé peuvent être utilisés pour revendiquer des droits opposés ou pour accuser l’autre partie de ne pas respecter les engagements pris. (Haïné 1995)
Un autre exemple emblématique d’ambiguïté linguistique dans la diplomatie internationale est celui de la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée en novembre 1967, juste après la guerre des six jours.
Le but de la résolution 242 était de jeter les bases d’une paix durable au Moyen-Orient, en établissant les principes fondamentaux pour la fin des hostilités entre Israël et les pays arabes limitrophes. Cependant, le langage de ce texte est devenu un symbole d’ambiguïté diplomatique et a fait l’objet de différentes interprétations.
Le litige commence entre une petite différence entre la version anglaise et la version française. La version anglaise demandait le « withdrawal of Israeli armed forces from territories occupied in the recent conflict ». La version française au contraire, affirmait : « retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés ».
Le fait que l’article déterminant « the » ne soit pas présent dans la version anglaise (« from territories occupied » laisse entendre qu’il y a possibilité d’un retrait partiel, et non obligatoirement de tous les territoires conquis par Israël pendant la guerre. (Lynk 2010). Par contre, dans la version française il y a l’article « des » (des territoires occupés), qui suggère le retrait complet de tous les territoires occupés. Cette différence grammaticale a eu des conséquences politiques énormes, avec deux interprétations opposées d’un document international fondamental.
Depuis, chacun a interprété le document en fonction de ses intérêts politiques. Israël a soutenu la version anglaise, l’interprétant comme un retrait de seulement quelques territoires, tandis que les représentants palestiniens et les pays arabes ont suivi la version française, dans laquelle le retrait des forces israéliennes des territoires occupés en 1967 était total (TV5 Monde 2014).
Cette ambiguïté linguistique intentionnelle était un choix politique conscient, car il est clair qu’un texte trop explicite aurait rendu impossible tout consensus entre les puissances du Conseil de sécurité. Malheureusement, au cours des années suivantes, cette ambiguïté s’est transformée en une tension permanente, parce que toute tentative de médiation du conflit, israélo-palestinien, a dû tenir compte de la résolution 242, dans la mesure où chaque partie impliquée, lisait le texte de la manière qui leur convenait le plus.
L’ambiguïté linguistique devient alors à la fois un pont et une barrière. Un pont parce qu’il permet d’atteindre un compromis minimal entre les deux parties, une barrière parce qu’elle empêche de résoudre les tensions définitivement, elles ne restent que gelées. (Lynk 2010)
Les accords de Minsk (2015)
Les accords de Minsk signés en février 2015 entre l’Ukraine, la Russie, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et les représentants des républiques séparatistes autoproclamées de Donetsk et Louhansk sont un exemple récent d’ambiguïté diplomatique. Ces accords avaient pour objectif de mettre fin aux combats dans le Donbass et d’essayer de créer les conditions d’un processus politique de pacification entre Kiev et les régions séparatistes soutenues par Moscou.
Cependant, ils ont toujours été écrits de manière volontairement imprécise et ouverte à des interprétations différentes. En effet, dans les expressions telles que « cessez-le-feu immédiat » ou « retrait des armes lourdes », on ne spécifiait pas les délais, les mécanismes de vérification sur le terrain et les modalités opérationnelles. Cette imprécision a donné lieu à plusieurs interprétations contradictoires. (Agence Anadolu 2025).
Pour le gouvernement ukrainien, le texte imposait une trêve totale et inconditionnelle, avec un retrait des forces armées, alors que pour les séparatistes du Donbass et pour la Fédération de Russie, les accords signifiaient des possibilités d’actions « défensives » ou « préventives » en réponse aux violations de l’Ukraine.
Par conséquent, comme il n’y avait pas de langage clair du point de vue juridique ni une autorité internationale capable de faire respecter les accords, le résultat fut un cessez-le-feu très fragile et constamment violé (International Crisis Group 2016).
L’ambiguïté, outre les questions militaires, concernait aussi les aspects politiques, par exemple la clause sur le « dialogue direct » entre Kiev et les représentants des régions séparatistes pouvait être interprétée de manière complètement différente. Pour la Russie et les séparatistes, cette formule semblait reconnaître un rôle politique autonome, comme s’ils étaient des interlocuteurs légitimes et indépendants. (United Nations 2015)
Pour l’Ukraine, cela signifiait d’ouvrir des consultations locales, mais gardant tout de même le plein contrôle et la souveraineté nationale. Ces accords, avec ces ambiguïtés linguistiques ont été possibles parce qu’étant un texte vague, il pouvait être accepté par les deux parties. Mais, inefficace, parce que cette imprécision a empêché de résoudre durablement le conflit. Dans tous les cas, les accords n’ont pas permis de préserver un minimum de dialogue tout en maintenant un espace politique où la diplomatie peut encore opérer (International Crisis Group 2016).
Le langage devient alors un moyen de contenir les conflits, à travers un équilibre provisoire entre la guerre et la paix.
Le langage diplomatique devient un espace de prudence, chaque terme est le résultat d’une réflexion et d’une stratégie. Contrairement au langage commun, le langage diplomatique ne vise pas la spontanéité mais la précision contrôlée. Comme nous l’avons déjà constaté, un seul verbe ou adjectif peut changer le sens d’une déclaration entière et influencer la perception d’un pays ou d’un dirigeant. Les diplomates apprennent à interpréter avec grand soin des expressions telles que « prendre acte », qui indique une distance prudente, « exprimer des réserves », qui évoque un désaccord contrôlé, »déplorer » ou « condamner avec force » qui représente la plus grande forme d’opposition verbale, conduit souvent à des sanctions ou des ruptures diplomatiques.
Ces expressions linguistiques, en utilisant l’équilibre, permettent en quelques mots d’éviter une confrontation directe. Par exemple, comme « le gouvernement X suit avec inquiétude les développements de la situation », cette commune désapprobation laisse place à un dialogue.
De plus, l’utilisation du conditionnel ou de la forme impersonnelle est souvent utilisée pour réduire la responsabilité politique. Par conséquent, en diplomatie, ce qui a été dit compte autant que ce qui n’a pas été dit. Chaque mot est une promesse implicite, et chaque silence est une stratégie. (ONU 2014)
LA LANGUE COMME INSTRUMENT DE POUVOIR CULTUREL ET SYMBOLIQUE
Si la langue structure la diplomatie, elle devient aussi un moyen de pouvoir et d’influence. Pour cela, les grandes puissances cherchent non seulement à imposer leur force économique ou militaire, mais aussi leur langue, qui peut devenir un moyen de transmettre les valeurs, les modèles culturels et les visions du monde. La véritable force d’une nation repose aussi sur sa capacité à séduire et convaincre les autres par la culture et le langage. (UNESCO 2025)
La langue n’est pas seulement un moyen de communication, mais un système de pensée. Pour cela, la diffusion de l’anglais au niveau mondial est à la fois une question pratique et politique qui reflète la prédominance économique, technologique et culturelle anglo-saxonne qui a influencé le langage diplomatique, scientifique et médiatique du XXIe siècle.
Les grandes institutions, comme l’ONU, l’Union européenne ou l’OTAN, reposent sur le principe du « multilinguisme ». Ce dernier garantit l’égalité entre les langues et le respect de la diversité culturelle.
À l’ONU, six langues sont adoptées : anglais, français, espagnol, russe, arabe et chinois. Chaque document officiel est traduit dans toutes ces langues, de sorte que chaque délégué puisse s’exprimer.(Organisation des Nations Unies 1946)
Cependant, l’anglais domine une grande partie des communications, des négociations et de la rédaction des textes officiels. Lorsqu’un concept politique ou juridique est formulé en anglais, il finit par transmettre une mentalité typiquement anglo-saxonne, c’est-à-dire pragmatique, orientée vers le résultat. Par exemple le terme accountability qui en anglais prend la signification de responsabilité, transparence et obligation morale envers la collectivité, ne couvre pas le même champ sémantique en français, italien ou arabe. Par contre, le français a tendance à utiliser plus de rationalité, avec une précision terminologique et juridique du concept.
De nombreux pays francophones défendent avec force l’usage du français dans la diplomatie, pour maintenir une forme de pluralisme linguistique et culturel. (France Diplomacy 2018)
Les institutions culturelles internationales comme l’Alliance française, l’Institut Cervantes, le Goethe-Institut ou le British Council sont les exemples les plus évidents d’instruments de diplomatie culturelle pour diffuser une certaine idée de civilisation. Ces institutions construisent un réseau de relations qui réunit des étudiants, des intellectuels et des professionnels du monde entier par le biais de cours de langues, de conférences, d’échanges universitaires, d’expositions et de projections.
Il ne s’agit pas seulement d’écoles de langues ou de centres culturels, ces organisations représentent la diplomatie culturelle qui se base sur la promotion linguistique, l’État diffuse son identité, ses valeurs et sa vision du monde, pas seulement le vocabulaire ou les règles grammaticales. Ils construisent des ponts invisibles entre différentes cultures, créent des réseaux de contacts et renforcent la perception positive d’un pays à l’étranger. (Papaioannou 2022)
De plus, la maîtrise d’une langue étrangère confère un avantage concret dans les relations internationales. Parler avec un interlocuteur permet de saisir des nuances, références culturelles et humour qu’un interprète ne peut pas toujours transmettre. La langue devient ainsi un pouvoir asymétrique, celui qui la connaît bien peut avoir plus de contrôle. Le recours à un interprète implique de filtrer les messages et les significations, et des nuances peuvent être perdues.
Ce n’est certainement pas un hasard si de nombreuses puissances émergentes investissent dans la promotion des bourses d’études, les échanges culturels et les échanges universitaires.
LA DIPLOMATIE NUMÉRIQUE
Avec le développement des réseaux sociaux et de la communication instantanée, la diplomatie ne se déroule plus seulement dans des espaces fermés ou dans des réunions multilatérales. Les ministères des affaires étrangères et les dirigeants utilisent de plus en plus de plateformes numériques pour communiquer directement avec les citoyens d’autres pays, les journalistes et l’opinion publique internationale. Facebook, Twitter, Instagram et même Tik Tok sont utilisés pour diffuser des messages officiels, répondre aux crises mondiales et promouvoir les politiques. (Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 2022)
Cependant, cette rapidité peut entraîner des risques significatifs liés à la langue. Parce que la traduction automatique, même si elle est très avancée, n’est pas parfaite. Cela peut conduire à ne pas saisir les nuances culturelles, le double sens et les références contextuelles. Un tweet officiel mal traduit risque de transformer un message neutre en une provocation, suscitant des réactions diplomatiques indésirables ou créant des malentendus. (Chaix 2020)
De plus, dans les réseaux sociaux, les conséquences d’un message mal traduit sont encore plus grandes, car il peut être vu et partagé par des millions de personnes en quelques minutes, atteignant des activistes, des leaders étrangers, des journalistes, avant que l’erreur puisse être corrigée. Ce phénomène a conduit à la diplomatie numérique, où la traduction devient un véritable outil stratégique.
Les bureaux de communication internationale investissent de plus en plus dans des traducteurs spécialisés, des réviseurs linguistiques et des logiciels avancés, travaillant avec rapidité et précision. Il existe également des cours de formation spécifiques pour les diplomates, afin d’apprendre à choisir les mots avec soin et à tenir compte des différences culturelles.
Il faut garder à l’esprit que dans la communication numérique, les destinataires ne sont pas seulement des États, mais des millions de citoyens avec des sensibilités différentes et des interprétations propres de la langue. Dans un monde globalisé et hyperconnecté, un mauvais mot peut avoir des effets immédiats et durables. De l’épisode de Mokusatsu en 1945 jusqu’à la résolution 242 de l’ONU, des stratégies linguistiques de Khrouchtchev et Kissinger à la diplomatie numérique d’aujourd’hui, l’histoire nous montre que les mots peuvent avoir la même force que les armes.
La langue est une force politique et symbolique qui influence les émotions, oriente les décisions et construit des relations de confiance ou de tension entre les nations. Les mots peuvent unir ou diviser, rassurer ou menacer, selon la façon dont ils sont compris, traduits et diffusés. Chaque terme choisi, chaque traduction officielle, chaque déclaration publique pèse très lourd dans l’équilibre des relations internationales.
Dans le monde globalisé du XXIe siècle, où la communication est instantanée, la responsabilité linguistique est un pilier de la diplomatie. Le diplomate moderne doit non seulement être polyglotte, mais aussi être profondément conscient du pouvoir culturel et symbolique que chaque langue a. Parler une langue ne signifie pas seulement connaître la grammaire, mais comprendre ses valeurs et ses implications historiques et culturelles.
La diplomatie contemporaine, en effet, n’est plus seulement celle des traités et des protocoles, mais aussi celle des traductions réussies, des nuances respectées et des mots choisis avec soin. Pour reprendre ce que disait Ludwig Wittgenstein, « les limites de mon langage sont les limites de mon monde ». Étendre ces limites signifie élargir les horizons de la compréhension mutuelle, construire une diplomatie des nuances, du respect et de la diversité.
Parce que dans le langage, plus que dans toute autre chose se joue une partie fondamentale du destin du monde.
Par Giulia Vitadello
Sous la direction de Laurent Attar-Bayrou, président de l’Académie Internationale de la Paix
BIBLIOGRAPHIE :
Wittgenstein, Ludwig (s.d). Tractatus Logico‑Philosophicus, prop. 5.6. Version française. Wittgenstein Project. https://wittgensteinproject.org/w/index.php?title=Main_Page
National Security Agency. Mokusatsu – One Word, Two Lessons. (s.d.) https://www.nsa.gov/portals/75/documents/news-features/declassified-documents/tech-journals/mokusatsu.pdf
Anna Aslayan, 2021 On the Diplomatic Mistranslation That Changed the Course of History https://lithub.com/on-the-diplomatic-mistranslation-that-changed-the-course-of-history/
1953 Kazuo Kawai, Militarist Activity between Japan’s Two Surrender Decisions https://www.jstor.org/stable/4492099
Pangeanic, 2023, Worst Translation Mistake in History https://blog.pangeanic.com/worst-translation-mistake
Alexandra Gouzeva, 2022. «Nous vous enterrerons»: que voulait dire Nikita Khrouchtchev? https://fr.rbth.com/histoire/87670-nous-vous-enterrerons-khrouchtchev
Idiomatic Translations 1996-2025 LLC. The Misinterpretation That Nearly Sparked World War III https://www.idiomatic.net/blog/translation/the-misinterpretation-that-nearly-sparked-world-war-iii
(DelicText -2024) Translators and Interpreters in Diplomatic Circles. https://delicatext.ch/en/translators-and-interpreters-in-diplomatic-circles/
Time Magazine Archives, 1956. Foreign News: We will Bury You! https://time.com/archive/6804927/foreign-news-we-will-bury-you
Wikipedia. (1959). We Will Bury You – Clarifications. Consulté dans la section “Clarifications”. https://en.wikipedia.org/wiki/We_will_bury_you
Aldo Matteucci, 2001. A practitioner’s view https://www.diplomacy.edu/resource/a-practitioners-view/
Waitangi Tribunal, s.d. Māori and English texts. https://www.waitangitribunal.govt.nz/en/about/the-treaty/maori-and-english-versions
Richard Dawson, s.d. WAITANGI, TRANSLATION, AND METAPHOR https://scispace.com/pdf/waitangi-translation-and-metaphor-cocyxloesc.pdf
Fiveable, s.d. Differing interpretations of the Treaty https://fiveable.me/history-new-zealand/unit-3/differing-interpretations-treaty/study-guide/pmGHkoH9i0pNnDuS
NZ History s.d. Differences between the texts https://nzhistory.govt.nz/politics/treaty/read-the-Treaty/differences-between-the-texts
2018 La souveraineté peut-elle se transférer ? Les enseignements de la traduction du traité de Waitangi (1840) https://www.erudit.org/fr/revues/ttr/2016-v29-n2-ttr03940/1051014ar
Media Myth Alert, 2011 The Zhou misinterpretation https://mediamythalert.com/2011/08/31/the-zhou-misinterpretation/
Quote Investigator, 2025. Dialogue Origin: “What Has Been the Impact of the French Revolution?” “It’s Too Early To Tell” https://quoteinvestigator.com/2025/04/02/early-tell/
Gérald Chaix, 2025, Reasearch Gate. Une histoire commune qui reste à écrire https://www.researchgate.net/publication/368447062_Conclusion_Une_histoire_commune_qui_reste_a_ecrire
Aziza Afkir, s.d Translation in Multilateral Diplomacy: Cultural and Political Hurdles https://translationjournal.net/Featured-Article/translation-in-multilateral-diplomacy-cultural-and-political-hurdles.html
U.S Department of State, 1978 Camp David Accords https://2001-2009.state.gov/p/nea/rls/22578.htm
TV5 Monde, 2014 Israël-Palestine : le poids des mots https://information.tv5monde.com/international/israel-palestine-le-poids-des-mots-1523#:~:text=Le%20ministère%20des%20Affaires%20étrangères,occupés%20par%20Israël%20depuis%201967”.
Agence Anadolu – 12.02.2025. Ukraine cease-fire agreement’s 13 points released https://www.aa.com.tr/en/politics/ukraine-cease-fire-agreements-13-points-released/75393
Unesco – 2025 Language matters: The role and the power of multilingualism https://www.unesco.org/en/articles/language-matters-role-and-power-multilingualism
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères – 2022 https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/digital-diplomacy/digital-soft-diplomacy
Manatū Taonga – Ministry for Culture and Heritage, 2019 Land confiscation law passed / New Zealand Settlements Act 1863 https://nzhistory.govt.nz/land-confiscation-law-passed
Waitangi Tribunal, s.d Māori and English texts / Ngā tuhinga Māori me te Ingarihi https://www.waitangitribunal.govt.nz/en/about/the-treaty/maori-and-english-version
Paul Meredith et Rawinia Higgins, 2015, Te Ara (Te Ara – The Encyclopedia of New Zealand): https://teara.govt.nz/en/kawanatanga-maori-engagement-with-the-state/print
Jean‑Yves Haine, 1995, “Diplomacy : la cliopolitique selon Henry Kissinger” https://journals.openedition.org/conflits/pdf
MICHAEL LYNK, 2010, CONCEIVED IN LAW: THE LEGAL FOUNDATIONS OF RESOLUTION 242 https://palquest.palestine-studies.org/sites/default/files/Conceived_in_Law_The_Legal_Foundations_of_Resolution_242-Michael_Lynk
International Crisis Group, 2016 Ukraine: Will the Centre Hold?, Europe Report N°247 https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/eastern-europe/ukraine
United Nations, 2015 Security Council Press Statement on Recent Maritime Tragedy in Mediterranean Sea https://press.un.org/en/2015/sc11870.doc.htm
Organisation des Nations Unies, 1946 https://www.un.org/en/our-work/official-languages
ONU, 2014, Deux siècles d’interprétation diplomatique : de la diplomatie formelle a la diplomatie de terrain https://www.un.org/fr/chronicle/article/deux-siecles-dinterpretation-diplomatique-de-la-diplomatie-formelle-la-diplomatie-de-terrain
L’Organisation Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (France), 2018 Stratégie internationale pour la langue française et le plurilinguisme https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/engagement-de-la-france-pour-la-diversite-linguistique-et-la-langue-francaise/strategie-internationale-pour-la-langue-francaise-et-le-plurilinguisme